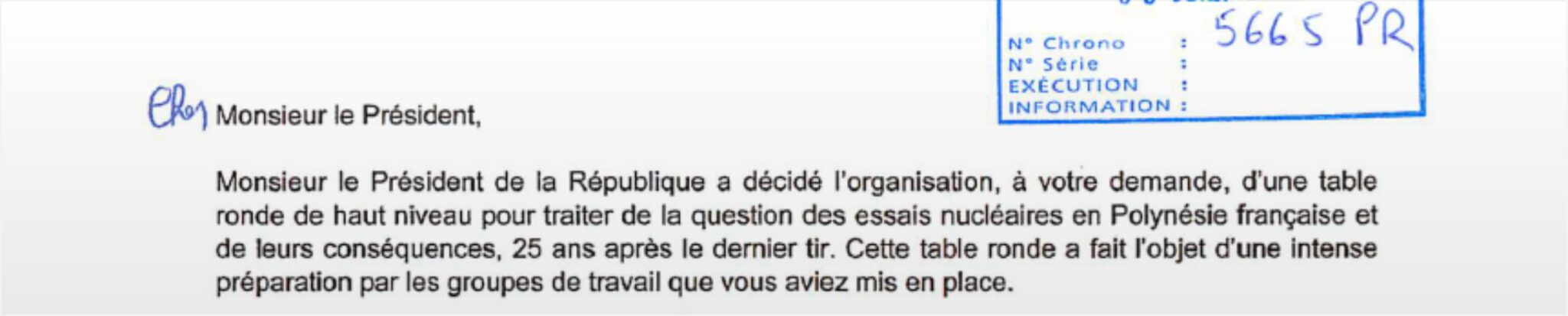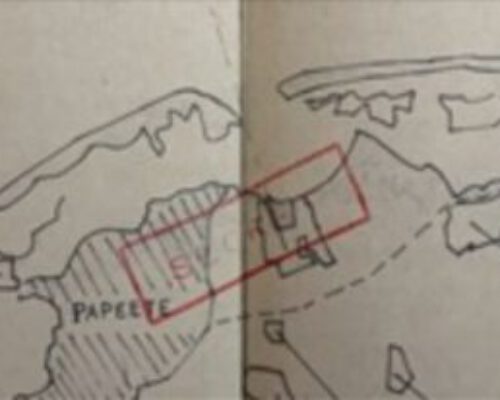Page 1
To’o hia ta’ata i rohi na i te CEP ra ? ’Aita te mau hi’ora’a ’āmui a te Hui-fa’atere (État-major) e tū’ati ra i te mau pāpa’a (données) a te DIRCEN, teie nei rā, ia firi-ana’e-hia te mau puna, e ti’a ïa ia papa fa’ahou mā te huru pāpū i te mau rahira’a ta’ata i tihepuhia e te CEP, fa’ehau e tīvira.
E fa’ehau te feiā patu matamua o te CEP. E 2 pupu fa’ehau i fa’anahohia : Ua ’āmui atu te Nu’u fa’ehau tāupo’o-’uo’uo i te ha’amaura’a i te 5ra’a o te RMP (pupu fa’ehau tūru’irau (mixte) nō Patitifa) mā te mau ti’a o te Pāito (Génie). Mai te tau pō’ai o te matahiti 1963 ra e tae atu i te tau pō’ai o te matahiti 1965 ra, [ua rohi] « te rima ’utuafare hope a te CEP », ua vāere, tāpū i te fenua, fa’ati’a i te mau fare hāmanihouhia, patu i te mau purōmu e mau taura’a manureva, « fa’atanotano » i te mau tahera’a pape, etv., i Tahiti ānei, i Moruroa ānei, e ’aore rā i Hao [1]. Ua pe’ape’a te māna’omana’o nā Porinetia i te taera’a mai te mau fa’ehau tāupo’o-’uo’uo, e pinepine ē e mau fa’ehau purutia (Heremani) tahito : i te 20 nō tiunu matahiti 1963 ra, ua pūhara te mau mero o te ’Āpo’ora’a [Fenua] i te haere’a mai o te mau « SS e te mau tūmate-ta’ata tārahuhia » [2]. Ua ’ite te tōmānā matamua o te CEP « i te tahi fa’atura-māramarama-’ore-ra’a hope i te Tōmānāra’a ’Ihitai i pāto’ihia » [3]. Te tahi atu pupu fa’ehau ra, te 115ra’a CMGA (Taiete Fa’aterera’a i te pāito o te Reva), e 200 ta’ata nō roto mai i nā pupu fa’ehau e 3 (Toul, Compiègne, e Toulouse) e « te tahi rima-turu nō Porinetia » [4]. Ua patu teie mau fa’ehau e 2 nā taura’a manureva i Moruroa i te matahiti 1964 ra : te ho’ē, fāito na’ina’i, auta’a, e te tahi ra, fāito rahi roa a’e – o tei fa’a’ohipahia nei ā i teie mahana. Ua fa’anahonaho rātou i muri a’e i te ārea [nō te] ora patuhia i piha’i iho i te ’oire nō ’Otepa, i Hao, e ua patu i te hō’ē taura’a manureva i reira hou a’e a tauto’o atu ai i te mau patura’a nō Fangataufa.
I muri a’e, tae mai nei te mau rave-’ohipa ’āpī. Ua fāito te tōmānā matamua o te CEP ia rātou ’ei mā’itira’a 2 (faufa’a-’ore nā te tahi vahi-’ē atu nō tōna fāito-maita’i ») [5]. Ua fāri’i te tenerara ra o Thiry ē : « Nō tē fa’aiti i te fāito-rahi, tītauhia e ha’amaita’i i te fāito-maita’i. ’E’ere te CEP i te ho’ē pupu fa’ehau mai ia Charleville e ’aore rā Romorantin, tē hina’aro nei au i te ho’ē pu’e-mā’iti » [6]. Te fa’auiuira’a nō te ’aravihi o te mau rave-’ohipa, ua nu’u i muri a’e nā te pae o te mau Porinetia, nō te mara’ara’a tāmau o te mau rahira’a rave-’ohipa e tae noa atu i te tārena matamua, nō te reira o Thiry i tītauhia ai ia ha’apāpū.
E mau fa’ehau rahi roa a’e i tei fa’aauhia na, i Tahiti e i Hao
E mau rahira’a fa’ehau fāito 12 500 i te ’āva’e tiunu matahiti 1966 ra
Ua ’āmaha te feiā-’ohipa fa’ehau e te pae fa’atere i te mau rave-’ohipa tāmau (« mau ti’a tauto’o »), « mau pāturu auta’a » (patura’a e ’aore rā fa’anahora’a i te mau pū) e te mau « pāturu ’aitere » (i te ’anotau o te mau tārena tāmatamatara’a). Mā te hi’ora’a fenua, ua ’ōperehia rātou nā Tahiti, Hao, Moruroa, e Fangataufa, e te mau ti’ara’a-’ohipa nā te paehiti.
Page 2
I te ’āva’e tenuare matahiti 1964 ra, i te ’ōmuara’a o te tahua-’ohipa, ua tāho’ē te CEP e 2 410 fa’ehau, mā te 2/3 o tei tonohia i Tahiti (68,5%). Tē taiā ra te mau huimana tīvira i te ho’ē ’ōta’ara’a o te rohi i te mau pū tia’i (base arrière). Ua fāri’i te ’ōpuara’a arata’i a te CEP, vauvauhia i mua i te mau fa’aterera’a-hau i te 15 nō fepuare matahiti 1964 ra, i te tanora’a o Tahiti mā te ti’aoro ato’a rā ē : « nō te tumu poritita, fa’arava’ira’a faufa’a, e pa’epa’e-’ohipa (logistique), tītauhia e ara ia ’ore ia tāho’ēhia te mau rahira’a rarahi e riro i te fa’ahuehue atu i te orara’a o te fenua » [7]. I te ’āva’e tiunu matahiti 1964 ra, ua fa’atāpae te tihepura’a tīvira i te mau rahira’a ta’ata honohia i te CEP i te fāito e 2 785. Ua vauvau Messmer i te tahi rāve’a (marotte) : e tari, ia au i tei mara’a, i te mau rohi e mau rave-’ohipa fa’ehau mai Tahiti i Hao atu. Teie nei rā, i taua taime ra, ua fa’a’ohipa ’ēna te CEP e 227 ta’ata o te motu, ’oia ho’i ho’ē ā ïa rahira’a i tō te huira’atira [8].
Tē ’aimamau ta’ata rahi noa atu ra te tahua-’ohipa. Mai nā ’āva’e tenuare e ’atopa atu nō matahiti 1965 ra, ua tāta’itoru te mau rahira’a ta’ata ’āmui : mai te 2 956 fa’ehau (2 001 rave-’ohipa tāmau, 955 ta’ata patu fare) e tae atu i te 9 000 ta’ata mai te peu ē e ’āmuihia te mau rave-’ohipa tīvira tihepuhia e te mau Nu’u, e i muri a’e, e te CEA. Tē tāpura-fa’ahou-hia nei rā, i tau taime ra, ia tāpae i te fāito raro mai i te 5 000 fa’ehau tāmau i te hope’a matahiti 1966 ra :
Te mau rahira’a ta’ata ’āmui ’itehia e fa’aauhia i te ’āva’e ’atopa matahiti 1965 ra [9]
Page 3
Teie nei rā, mā te mau pāturu ’aitere, e tae’ahia te tāta’ipiti. I te 30 nō tiunu matahiti 1966 ra, i na’uanahi (à la veille) i te tūpitara’a matamua, ua tihepu te CEP 12 531 fa’ehau (2 708 [nu’u] Fenua, 8 720 [nu’u] ’Ihitai mā te force Alpha, e 1 103 [nu’u] Reva) [11]:
Inera’a o te mau rahira’a fa’ehau a te CEP mai tiunu matahiti 1964 ē tiunu 1966 atu [12]
Page 4
I te ’āva’e tetepa matahiti 1966 ra, ua tu’u te mau Nu’u fa’ehau i te Tomite tī’a’au nō tē fa’aiti i te mau fāito-hōpoi’a a te CEP, te ’ōperera’a i nā 12 427 fa’ehau tihepuhia. E teiaha rahi roa te [nu’u] ’ihitai, nō te uta-moana-ra’ahia te tahi pae rahi o te feiā-’ohipa :
SHD, GR 9 S 93, Parau Tāpiri o te Parau Haruharu nō te 3ra’a o te putuputura’a o te Tomite a te CEP fa’atupuhia i te 19 nō tetepa 1966 ra, i Paris, i te 26 nō tetepa 1966 ra.
Figure 3
SHD, GR 9 S 93, Annexe au PV de la 3e réunion de la Commission du CEP tenue le 19 septembre 1966, Paris, le 26 septembre 1966.SHD, GR 9 S 93, Parau Tāpiri o te Parau Haruharu nō te 3ra’a o te putuputura’a o te Tomite a te CEP fa’atupuhia i te 19 nō tetepa 1966 ra, i Paris, i te 26 nō tetepa 1966 ra.
Page 5
I mua ia Ailleret, o tei ha’amau i te Tomite i hina’arohia e Messmer, ua tātarahapa ’o Thiry mā tē fa’ahiti ato’a rā i tei tupu na i Sahara : « Ia fa’aoti-ana’e-hia te mau rahira’a ta’ata, ua ’ite ’oe e a’u tenerara ē, e ti’a [ia tātou] ia turu ia rātou nō te mau ’ohipa tanotano : fa’atāmā’a ia rātou, ha’apūhapa ia rātou, e aupuru ia rātou, etv. E topa [tātou] i roto i teie ’ohipa parau rahi nō te ’āpapara’a tū’ati o ta ’oe i ’ite maita’i na i Reggane. Ua tū’ati mau na te ’āpapara’a, e e tae [tātou] i nia a’e i te fāito-’ōti’a i mana’ohia e tātou. E fifi rā teie e vai nei » [14]. I te ’Āpo’ora’a nō te Pārurura’a nō te 14 nō Novema matahiti 1966 ra, o tei ho’i mai i ni’a i te tārena matamua, ua tītau o Pompidou i te fa’aitira’a i te mau rahira’a ta’ata [15]. Ua ’ōta’ata’a marū noa rātou. I te hope’a matahiti 1967 ra, ua tihepu fa’ahou te CEP 9 244 fa’ehau e 3 300 tīvira, mā te 1 830 Porinetia. I te hope’a matahiti 1971 ra, ua tihepu te CEP e 5 971 fa’ehau tāmau mā te 1 790 nō te tau fa’ehau.
E mau fa’ehau fātata roa ē e rahira’a tāne ana’e, e ’europa ho’i te pae rahi
I te matahiti 1966 ra, i rotopū i nā 7 004 fa’ehau « tauto’o » e, e 76 vahine e vai ra i te CEP, ’oia ho’i i raro iti noa mai i te 1% o te mau rahira’a ta’ata. Mā nā 5 575 [fa’ehau] pāturu (5 393 [fa’ehau] ’ihitai ihoā rā nō te pupu Alpha), ua tāho’ē te tārena matamua i e to’ofanu 12 500 fa’ehau, i te ’āva’e tiurai ra, fātata te tāato’a e tāne ana’e mā tē fa’atupu i te ho’ē harura’a fenua mana’o-’ore-hia e te au-’ore o tei ’itehia e Thiry : « Ua fa’aō mai te ho’ē aumanava « pāto’i-papa’ā » i roto i te mau ferurira’a nō te mau tumu e rave rahi, e ’inaha ho’i ē, a ’ū’ana noa ai te anira’a [’ohipa] a te mau tāne ra, tē tōitiiti nei ïa i te fa’aanira’a [’ohipa] a te mau vahine »[16].
Tore | Fenua | ’Ihitai | Reva | Mūto’i farāni / Ture fa’ehau | ’Āmui |
’Ōfitīe tau tāvini | 127 | 165 | 98 | 4 | 394 |
’Ōfitīe tau fa’ehau | 8 | 9 | 2 |
| 19 |
’Ōfitīe ’Āmui | 135 | 174 | 100 | 4 | 413 |
’Ōfitīe-raro tau tāvini | 680 | 919 | 455 | 32 | 2086 |
’Ōfitīe-raro tau fa’ehau | 33 |
|
|
| 33 |
’Ōfitīe-raro ’Āmui | 713 | 919 | 455 | 32 | 2119 |
Tāne tau tāvini | 671 | 1589 | 53 |
| 2313 |
Tāne tau fa’ehau | 853 | 812 | 418 |
| 2083 |
Feiā-’ohipa vahine | 65 | 1 | 10 |
| 76 |
Fa’ehau tāne ’Āmui | 1589 | 2402 | 481 |
| 4472 |
’Āmui | 2437 | 3495 | 1036 | 36 | 7004 |
Tāato’a o te mau rahira’a fa’ehau i te 31 nō titema matahiti 1966 [17]
Page 6
Te fāito o te mau fa’ehau nā te mau motu, i Hao ihoā rā, o tei riro ’ei pū mata-ara (base avancée) nō Hao :
| Papeete | Hao | Pū | ’Āmuira’a CEP | ’Āmui |
Fenua | 1 247 | 577 | 174 | 151 | 2 149 |
Reva | 354 | 494 | 46 | 189 | 1 083 |
’Ihitai | 404 | 138 | 243 | 8 106 | 8 891 |
Mau tāvinira’a ’āmui |
|
|
| 109 | 109 |
’Āmui | 2 005 | 1 209 | 463 | 8 555 | 12 232 |
Tāato’a o te mau rahira’a ta’ata i te ’anotau o te tārena tūpitara’a matamua, i te 30 nō tiurai matahiti 1966 ra [18]
I Tūreia, e 90 ta’ata tā te mau fare fa’aineinehia e fāri’i, ’oia ho’i ua hau atu i tō te huira’atira. I te matahiti 1971 ra, tei ni’a te nohora’a i te 109 ro’i.
E mau tīvira porinetia nō te mau tumu ’ihiha’a e poritita
I te matahiti 1962 ra’a ra, ua fa’ariro te tenerara Thiry i te mau perera’a poritita o te fa’a’ohipara’a i te mau Porinetia nō tē ārai i te « tāpiripiri », ’ia ’āpe’e te CEP i te fa’a’tau’āpīra’a i te ho’ē tōtaiete porinetia o tei ineine, ia au i tāna hi’ora’a, ia tomo i roto i te ho’ē fa’anahora’a aotahihia.
Te tahi hina’aro poritita ’ume’umehia e te mata’u i te mau rāterera’a tāmau
Ua fa’a’ō Thiry i te tihepu-’ohipa nā te fenua nei i roto i te tāpura fa’aani a te mau taiete unuma. Ia au i te ho’ē tua’irava, « e ti’a i te fatu-’ohipa ia tihepu mā te fāito-rahi roa a’e i te rima-’ohipa nā te fenua nei », te ho’ē rēnira’a mā tē fa’aara « e ’e’ita ’oia e rave i te rima-’ohipa nō rāpae mai maoti rā tō te haumetua i muri a’e i te fāri’ira’a mana a te Ra’atira o te Fenua » [19]. I te matahiti 1962 ra, i ni’a i te rahira’a e 84 500 ta’ata, e 28 000 rave-’ohipa tau tāvini tā Porinetia, mā te 11 000 ana’e rave-’ohipa ’aufauhia – ia fa’aauhia i te fāito e 7 250 rave-’ohipa i te matahiti 1960 ra [20]. Ta’a’ē atu ai te tihepu-’ohipa heru i Makatea o tei fa’atupu i te mau nanura’a i rotopū i te mau ta’amotu, nā roto i te tāvirira’a-hoho’a Révoltés du Bounty, ua fa’atupu te MGM i te huimoni-’āva’e (salariat) ia au i te fāito nō Tahiti. I te ’āva’e tenuare matahiti 1964 ra, tē hurihuri ra te tohura’a nō te mau vatara’a o te rima-’ohipa i rotopū i te fāito 800 e 2 500.
No Thiry, e mea ’ohie a’e e te māmā a’e ho’i ia fa’a’ohipa i te rima-’ohipa nō te fenua iho, i te fa’areva mai i te mau tīvira, teie nei rā ho’i, tei ni’a a’e tōna fāito-moni i tō te tihepura’a fa’ehau : « e mea hau a’e nā ’u e tūru’i maita’i roa i ni’a i te mau rāve’a fa’ehau nō te mea o te Upo’o parau III ïa o te mau Nu’u fa’ehau teie e uiuihia ra, e ’inaha ia rave ana’e au i te ho’ē rāve’a tīvira, e mea moni rahi roa atu ïa, e teiaha roa atu ho’i tā ’u tāpura faufa’a » [21]. « Ia tihepu ana’e au i te mau Porinetia, e hāpono vau i te parau-pe’era’a tāato’a. Mai te peu ē e mau fa’ehau ti’ara’a 2 tā ’u ra, e hāpono noa ïa vau ho’ē ana’e tuha’a o te parau-pe’era’a ». Ua tāpa’o o Vedel, o tei hi’opo’a i te CEP i te matahiti 1966 ra, i roto i tāna puta-tāpa’opa’o : « E ti’a mauā e fa’ahepo i te CEP, o tei au a’e e mā’iti i te rima-’ohipa fa’ehau » – i tō te tīvira porientia [22]. « ’Oia mau, e ti’a mai te mau aupupu e te
Page 7
aumanava nō tē pāto’ira’a », ’e’ita rā teie hi’ora’a e ha’afifi i tē fa’aau i te ho’ē tā’atira’a tītauhia nō te mau tumu poritita, e te faufa’a moni ato’a rā ho’i : ’aita te CEP e ’aufau nei i te mau fa’ehau i ravehia mai roto mai i te mau nu’u ta’a’ē, teie nei rā, e tuha’a ato’a tā rātou i roto i te tāpura faufa’a ’āmui a te Hau…
Ua nānā te DirCEN i ni’a i te feiā o te mau ta’amotu. Hope’a matahiti 1965 ra, ti’aturi a’e nei o Thiry « e riro i tē vata mai, i te matahiti 1967, nā 600 rave-’ohipa nō te repo ma’atea [i Makatea], [nō te mea] tē pau atu ra te puna » [23]. ’Oa’oa iho nei o Vedel i te reira i te ’āva’e ’atopa matahiti 1966 ra : « ua vata mai te rima-’ohipa nō te repo ma’atea ». Teie nei rā, nō tē ārai ’eiaha ia ’ōta’ata’a haere te huira’atira nā roto i te mau rāterera’a hope’a, ua hina’aro te tāvana rahi ra o Grimald i te fa’aaura’a ’ohipa tau poto : e 2 ’āva’e nō tō Tuha’a Pae, e 3 ’āva’e nō tō Matuita. I te matahiti 1965 ra, ua fāri’i ’oia e « e 3 ’āva’e, e e 4 ’āva’e ta’a’ē nō tō te mau fenua Matuita » [24]. Ua tihepuhia tō te mau ta’amotu nō te mau pū ihoā rā. I Tahiti, « tōna tanora’a, te mau rave-’ohipa nō te fenua ana’e tē tihepuhia ». Ua tāpa’o-rarahi-hia rā te feiā nō Raro-Mata’i. Ua tai’o te fa’aterera’a 100 ta’ata fa’areva mai Raro-Mata’i i te mau pū atu i te ’āva’e novema matahiti 1964 ra, ’ēna 500 i te ’āva’e fepuare matahiti 1965 ra, 1 000 i te ’āva’e mē matahiti 1965 ra, 2 000 i te ’āva’e tenuare matahiti 1966 ra, e 2 500 i te ’āva’e tiurai matahiti 1966 ra [25].
E rāve’a e tu’i atu ai te parau o te CEP nā te Fenua nei
I te ’āva’e māti matahiti 1963 ra, ua tūrama o Grimald i te mau ti’a-mana porinetia ē e fa’a’ohipahia atu « te rima-’ohipa nō te fenua nei » nō « tē rave i te mau patura’a matamua », e i muri a’e, tō te terera’a o te CEP o tei tītauhia ia tihepu i te « mau rave-’ohipa ta’a-pāpū e te maita’i, te feiā-’ohipa piha-’ohipa, e utuutu fare, etv, mā tē ha’amatara maori i te mau ’uputa ’āpī nō te ’ohipa nā te u’i-’āpī porinetia, e mā tē ’āmui ato’a atu « i te fa’aineinera’a tōro’a » [26]. Ua fa’atupu te tāvana rahi i te tahi pū-’ohipa Fa’atū’ati e ’Ōhipa-’Āmui nō te tāu’aparau e o te CEP. I Paris, tē fa’aitoito ra o Messmer i te tihepura’a i tō te fenua [Porinetia]. Te Cema ra o Ailleret, ua ha’apū’oi ’oia i te hina’aro o tāna fa’atere-hau, i te putuputura’a matamua a te Tomite a te CEP i te 21 nō tiurai matahiti 1966 ra, nō tē « fa’aiti i te rahira’a fa’ehau ’ei turu, mā tē pi’i, ia au i tei mara’a e hope roa, i te huira’atira fenua », a fāri’i noa ai ’oia ē « ’aore e ta’a-maita’i-hia ra te itoti’a (capacité) ’ohipa [o tō te fenua] » [27].
E parau ’ē atu ā ïa te reira nā te pae ’aitere. Ua fa’aau-’ore o Thiry i te tihepura’a i tō te fenua nei. E ’inaha nā te hi’ora’a i te « pūai i ni’a i te ’ohipa », ua tu’u ’oia i te « fāito 2 » nā te mau fa’ehau tāupo’o ’uo’uo, te « fāito 1 » nā te mau ti’a tau fa’ehau, pāito nō te pupu tau fa’ehau », e ua fa’ata’a i te « fāito ½ nā te mau Porinetia, ia au i te parau nō te utara’a, te mau tere-haere e tere-ho’i » [28]. ’Aita te reira e ha’afifi ra i te ’atimarara Lorain, tōna [Thiry] mono e GOEN, ia fa’aō mai i te fa’auera’a poritita. Ua tūrama ’oia i te ’atimarara Vedel, o tei haere mai e hi’po’a i te mau pū i muri a’e i te tārena matamua : « Tītauhia te CEP ia tūru’i i ni’a i te rima-’ohipa e te nūna’a ».
I rotopū rā ho’i i te mau fa’ehau e tō te fa’aterera’a tīvira, tē ō mai nei te tahi atu ti’a : te unumā. Ua fāri’i o Noël Frogier, te ti’a tihepu rave-’ohipa nō te taiete repo ma’atea nō Makatea, i te ho’ē ā tītaura’a mai roto mai i te CEP : te tihepura’a i te mau Porinetia mātau i te huimoni-’āva’e (salariat). Ua ha’amau ’oia i te mau mā’itira’a nō tē tihepu i te feiā-’ohipa fa’ata’ahia nō te mau tuha’a
Page 8
’ohipa rave ’atā. Ua ’iriti ’oia i te ho’ē piha-’ohipa i Pape’ete, e ua tere nā te mau motu o tei mātau ia na [29].
Tē rava’i-’ore noa atu ra te rima-’ohipa o te fenua nei
’E’ita te tihepura’a ’ohipa nā te fenua e rava’i nō tē pāhono i te mau anira’a a te CEP o tei ha’amarō i te punavai ta’ata. I te ’āva’e ’eperēra matahiti 1964 ra, ua fa’a’ohipa te CEP e 3 200 tauturu-’ohipa porinetia, o tei fa’atupu i te ho’ē « maumaura’a, e tae roa atu i te mau-roa-ra’a o te mau ’ohipa i pūpūhia i te mau taiete o te fenua nei » [30]. Ua ha’ape’ape’a te CEA i te ho’ē « fāito tāhānerera’a iti o te tihepu-fa’ahou-ra’a » [31]. Ua amuamu te mau feiā-’ohipa i te pae nō te orara’a mā e te orara’a maita’i hōhia mai e te SGTE » [32] (ha’apa’ora’a-’ore o te mau vāhi tapi vai e haumiti), e nō te teimahara’a o te mau hora [’ohipa] : te « fāito-hora ’ohipa ti’a », e 44H i Pape’ete, e 54H nā te mau pū. I te matahiti 1965 ra, ua tūrama te tahi parau ha’apapa a te ’Āpo’ora’a Huitoofā i te mau paruparu nā roto i te mau fa’anahora’a tūēā-’ore i rotopū i te rave-’ohipa o te fenua nei e tō te haumetua : « Ua tupu te mau paruparu [nō te ’ere] o te ho’ē orara’a tura i hōro’ahia nō te mau Porinetia o tei ’ana’anatae roa i tē ho’i i tō rātou fenua ».
I tau pō’ai matahiti 1965 ra, ua nūmera te tāvana rahi e 3 500 Porinetia e ’ohipa ra i Hao e Moruroa. [33] I te ’āva’e novema matahiti 1965 ra, ua fāito Thiry i te reira ’ei 3 150 mā te hau atu i te ’āfara’a mā te mau taiete. Ua tāpa’o ’oia e fa’ahaere mai 300 e 1 500 atu rave-’ohipa porinetia tihepuhia e te mau nu’u [34]. I taua taime ra, ua fāito te tōmānā o te CEP i te mau rahira’a ta’ata i te 7 000 rave-’ohipa tāmoni porinetia, te tāato’a o te mau fatu-’ohipa e te mau pū, i ni’a-’ē maita’i i te mau tohura’a. Ua fa’a’ohipa pae-rahi-roa-hia e te tahi mau taiete unumā i te mau Porinetia : ua fa’a’ohipa o Dumez e 925, ’oia ho’i e 65% o te mau rahira’a ta’ata i ni’a i te tahua [35] :
Page 9
Haumetua |
Fa’atere, Arata’i* OQ + OS Tāato’a | Moruroa & Fangataufa | Hao | Papeete | ’Āmui |
15 | 2 | 5 | 22 | ||
77 | – | 13 | 90 | ||
156 | 6 | – | 162 | ||
248 | 8 | 18 | 274 (49) | ||
Pōtītī (Uāhutarema) | Tauturu-’ohipa | 236 | – | – | 236 (16) |
Tō te Fenua | Arata’i | 5 | – | 1 | 6 |
OQ | 66 | 3 | 33 | 102 | |
OS | 96 | 13 | 24 | 133 | |
Tauturu-’ohipa | 613 | 24 | 47 | 684 | |
Tāato’a | 780 | 40 | 105 | 925 (175) | |
’Āmui Tāato’a |
| 1246 | 48 | 123 | 1 435 |
* Arata’i = ra’atira ’ohipa
Te mau tāpa’o-pāruru, nō tē ha’apāpū ïa i te rima-’ohipa hotu-’ore (nō te ’ere i te fa’atere vata)
’Ōperera’a o te mau rahira’a ta’ata a te taiete Dumez-Citra i te 31 nō ’Atete matahiti 1965 ra [36]
Tē tauvere ra te mau pāpa’a (donnée) : i te hope’a matahiti 1965 ra, ua tai’o te tahi parau-tāpa’opa’o fa’ehau e 3 550 rave-’ohipa porinetia nā te CEP, mā tē ha’apae i te ’ohipa fa’a’apu, o tei pau e 2 500 rave-’ohipa, e « 445 rave-’ohipa ’e’ē o tei tītauhia e fa’ahaere mai ». « Hau atu i te 1/3 o te mau tāne o tei fa’aru’e i te fa’a’apu nō [tē haere io] te CEP ra, e ua mara’a te tuha’a-’aifāito hau atu i te 2/3 nō te mau taure’a ». [37] Tē mata’u ra o Grimald i te tere o te va’amata’eina’a, e ua tūrama o Thiry, i Paris, e tītauhia ’oia « ia feruri i te mau peu tumu » : « ua ani mai te tāvana rahi ia mātou ’eiaha e rave i te tāato’a o te mau rima-’ohipa » [38].
Ua pāhono te mau rave-’ohipa tāmoni porinetia i te fa’aanira’a, e ua tāmata i tē ha’afaufa’a i tā rātou e hina’aro ra : te CEA, ’eiaha rā te mau Nu’u e te mau taiete ; Hao, tōna ’oire ia ’Otepa e tāna mau vahine, ’eiaha rā Moruroa, e tāne ana’e ïa. Te mau taiete nō te fenua nei, o tei fa’a’ohipa i tā rātou mau rave-’ohipa e 60H tāhepetoma nō tē fa’aho’ona i tō rātou mau fifi tihepura’a, ua mutamuta ïa « i te mau rave-’ohipa e ani tu’utu’u-’ore nei i te ha’amara’ara’a moni ’ohipa » [39].
I muri a’e i te tahua-’ohipa, ua vaivai te mau rahira’a ta’ata porinetia i te CEP i te fāito e 2 500. I te matahiti 1966 ra, ua ti’aturi o Thiry e tē piri atu ra ’oia i te fāito-’ōti’a « i te mea ē e 3 000 Porinetia e vai nei nā te mātete ’ohipa, mā tē tai’o i tei maita’i ’ore roa a’e, te feiā ’aore e ta’a maita’i ra » [40]. I te matahiti 1967 ra, e 2 432 (1 830 tihepu-fenua-hia e e 602 rave-’ohipa fa’aturehia) [41]. I te matahiti 1974 ra, matahiti hope’a o te tārena [tāmatamatara’a] ’apura’i (atmosphérique), ua fa’a’ohipa te CEP e 2 580 Porinetia, mā te 1 787 i te mau nu’u, e 793 i roto i te CEA [42]. I taua taime ra, ua tihepu te CEA, nō tē ravera’ahia te mau tāmatamatara’a raro-fenua, auhānere Porinetia nō te mau ’ohipa pa’ora’a ’āpo’o, hou a’e a fa’aitoito ai i tō ratou ho’ira’a.
Page 10
I te hope’a, ia au i te mau fāitora’a a te DSCEN, 10 e 12 000 atu Porinetia o tei rave i te ’ohipa i te CEP, mai te tahua-’ohipa e tae roa atu i te tārena hope’a, e piri i te 100 000 ’Europa.
Te mau ’ohipa tei iti i te maita’i ’ei reira te mau Porinetia i te fa’atata’ura’ahia rātou rātou iho e i te mau Pōtītī (Uāhutarema)
Te hi’ora’a ’europa i te rima-’ohipa o te fenua nei, fa’aau-’ore-hia, e mea itoito rā
I te taime nō te tahua-’ohipa, ua ha’avā ’eta’eta o Thiry i te fāito fa’aineinera’a o te mau Porinetia : « Te tau-ha’api’ira’a o te mau taure’a, e huru tāpae hope ia au i te fāito tuatahi, i muri mai rā, e paruparu rahi roa ïa ». Teie nei rā, ua mana’o ’oia ē o « te fa’aineinera’a tōro’a i noa’a “i ni’a i te tahua”, ua riro ïa ’ei papa matamua, e tano mā tē fa’anaho i te ho’ē « ha’api’ira’a ’iteha’a » [43]. Ua rave te mau fa’atere o te CEP i te tahi ’ihita’ata ’ētene e fa’a’ite mai ra i tō rātou iho hi’ora’a : « E huira’atira māramarama e te ’ā’au-here te mau tāne e vahine Porinetia. […] Te taura ta’ata, papahia e te mau ’āno’ira’a ’oa’oa e te mau ’Europa e ’aore ïa ’Ātia [Tīnītō], e tino huru pāutuutu, ia au i te huru orara’a, nō raro roa mai, e fa’ahupehupe maita’i ïa ia rātou » [44]. Hi’o aumetua-tāne a’e nei te tenerara Crépin : Te mau Porinetia, te vai ra « tō rātou mau maita’i e mau paruparu tino ta’a’ē i tō te mau ’Europa, mā tē ’aravihi tumu fa’ahiahia mau nō te mau ’ohipa tautai miti, mā te ’ohipa hā’uti rā e te tāmau-’ore i roto i te ’ohipara’a, mā tē fa’aru’e ’ohie i tā rātou ’ohipa-tāmoni mā te tumu-’ore ». Ua ha’apāpū, mā te tāpe’ape’a-’ore, o Lorain i mua ia Vedel : « E mea ’aravihi te ta’ata Tahiti, ’aita rā e hina’aro ra e rave i te ’ohipa ».
I te pae nō te fa’aho’onara’a, ua rave te mau fa’ehau i te mau nūmerara’a ’aivāna’a, ia au i te hi’ora’a nō te ’ohipa ’ite-pāpū-hia. I te matahiti 1965 ra, ua mana’o o Thiry ē « te ho’ē rave-’ohipa porinetia, i te pae nō te tauturu-’ohipa e nō te mau ’aravihi ta’a-maita’i, e tāta’ipiti roa te paruparu o [tōna] fa’aho’onara’a i tō te ho’ē rave-’ohipa ’europa e noho tau poto mai i Porinetia (1 e ’aore rā e 2 matahiti) » [45]. Ua nu’u rahi roa atu te ho’ē ’ōfitīe i roto i teie hi’ora’a tō’ihivāna’a mā tē fāito, ia au i te ’aitoro (indice) 100 e tū’ati ra i tō te pāito nō te 5ra’a o te RMP, e 125% tā te fa’ehau tāupo’o ’uo’uo, e 60% tā te ta’ata Tahiti [46]. I te ’āva’e tetepa matahiti 1966 ra, ua ani te tenerara Crépin i te ho’ē tuatāpapara’a nō te fāito-hōpoi’a nō te « ho’ē fa’ehau tauto’o, te ho’ē ti’a tau fa’ehau haumetua, te ho’ē ti’a tau fa’ehau porinetia, e te ho’ē rave-’ohipa porinetia ia au i te maorora’a o te nohora’a mai te mau [haumetua] » [47].
Ua ine teie mau hi’ora’a ia au i te huru o te ’ohipa. I ni’a-’ē i te mau tauturu-’ohipa, tau poto, i ni’a i te tahua-’ohipa, ua fā mai te mau ti’ara’a [’ohipa] ’āpī mā tē hōro’a i te tanora’a nō te ’ohipa tumu tau roa. ’Ei hi’ora’a, ua fa’a’ohipa te Piha-’ohipa nō te mau ’Ohipa-’ihitai i te mau ta’ata hopu nō te mau pū, te mau ta’ata patapata parau nō tāna mau piha-’ohipa i Pape’ete, 1 tauturu mātutu-faufa’a, e 2 ta’ata tāpa’opa’o, 1 ta’ata fa’ahoro pere’o’o, e 2 ta’ata tātā’ī mātini, 1 vahine tāmā, 1 ta’ata ha’apa’o tao’a, 1 ta’ata tunu mā’a… nō te ho’ē ana’e tauturu-’ohipa. Te moni-’ohipa a teie [tauturu-’ohipa], e tāta’ipiti ïa i raro mai i tā te mau ta’ata hopu.
Te raupēa i te mau maita’i ’ihitai o te mau Porinetia, e ’itehia i te taime nō tē fa’ararahira’a i te ava nō Fangataufa « mā te mau huru fifi roa nō te mau rave-’ohipa porinetia o tē fa’atupu i te fa’ahiahia i rotopū i te mau ’are fāfati e te mau ma’o » [48]. « E ’ihitai fa’ahiahia te Porinetia », o tē fāri’ira’a ïa Thiry : « Poti ’ōroe, pahī, faura’o ri’i uta tauha’a, LCR, etv… e tano te reira ia ha’apa’o-hope-roa-hia e te mau feiā-’ohipa porinetia » [49]. Ua fāri’i o Crépin i te ho’ē itoito e ua fa’a’ō fa’ahou
Page 11
’oia i te mau ta’ata Tahiti i roto i teie tua’ā’ai, o tē riro atu ’ei mana nō te ’Europa : « Teie nei rā, ua tau te mau Porinetia i te ho’ē fa’atanora’a ’āpī roa mā te vitiviti maere rahi ».
Ua fāri’i ’oia mai te ho’ē parau nō te fifi te fa’aterera’ahia e te mau haumetua te rima-’ohipa nō te fenua nei, e ua tītau ’oia ia ha’amaita’ihia « te ’ite nō te huru fa’aterera’a i te reira » i roto i te tahi fa’anahora’a tūēā o te mau ’aitauira’a : « Nō te ha’afaufa’a i te mau rave-’ohipa mai teie te huru, tītauhia te tahi arata’ira’a faufa’a e te maita’i » [50].
I taua taime ato’a ra, ua fa’atata’uhia te mau Porinetia rātou rātou iho, e i te mau rave-’ohipa ’e’ē. I rotopū ia rātou iho, nō te mea ho’i ē, te fa’ata’a nei te mau fa’ehau i te ta’ata Tahiti i te mau Porinetia nō te tahi atu mau ta’amotu nō te mau tumu hiro’a (« te fāito-ha’iha’i o te fa’aho’onara’a i te tauturu-’ohipa porinetia ia fa’auhia i te tauturu-’ohipa Tahiti, nō roto mai i te ta’a-’ore o tō te mau motu i te ’ohipa nahonaho e te tāmau ») e pa’epa’e-’ohipa (logistique) : « ’e’ita e ti’a ia fa’atū’ati i te mau fa’aura’a-’ohipa i te mau terera’a pahī e tari nei i te mau feiā-’ohipa » [51]. E tano ato’a te fa’aaura’a i te mau Pōtītī (Uāhutarema) e utahia mā te mau pupu tau fa’ehau, i te taime a taere ai te mau tāpura ’ohipa i Hao o tei arata’i i te Dircen ia ani i te parau-fa’ati’a a te tāvana rahi nō teie tihepura’a i te feiā ’e’ē [52] « nō te o’e o te rima-’ohipa noa i Porinetia » [53]. « Te tihepura’a i te mau Pōtītī mā te parau-fa’aau nō te 6 ’āva’e [54] », ua tae ïa ia fa’a’ohipa e 250 ta’ata i te ’āva’e ’atete matahiti 1965 ra [55]. Ua ’itehia ’e’ita rātou e tano nō tē ’ohipa nā te mau motu : « Mai tāpa’o ato’a ana’e tātou ē ua fa’ahiro’aro’a maita’i mai te mau rave-’ohipa porinetia i tō rātou ’aravihi nō te mau ’ohipa nā te moana e tae roa i rōpū i te mau ’are fāfati. ’Āre’a i te mau Pōtītī ra, a pāutuutu atu ai ho’i i ni’a i te ’ohipa, e mea huru aroha ïa nō teie nei ā tuha’a » [56]. Ua tāpa’o maori rā ho’i o Peyrefitte i roto i tāna mau puta-tāpa’opa’o ē « te taere i tupu na, ua fa’aho’ihia » maoti te tihepura’a i teie mau Pōtītī.
E mau Porinetia i mua i te « fa’atau’āpīra’a »
Tē fa’ateitei nei te mau fa’atere o te CEP ia rātou iho i tō rātou rirora’a ’ei mau aveave nō te ho’ē tauira’a vitiviti, nā roto i te mau poro’ira’a rarahi i te mau tauha’a e te mau tao’a o te mau ’ohipa rarahi. I te hopea matahiti 1965 ra, ua fa’a’ohipa te CEP e 12 000 tane tīmā, e 236 tane pēni, e 563 tane punu tāpo’i e pāruru-roto (amiante). ’Oia ato’a rā te mau mātini hāmani uira e 93 tane, e 566 tane niuniu uira e mauha’a uira, 1 259 tane fa’atahera’a pape… Te matahiti 1965 ra, o te matahiti ’ū’ana roa a’e ïa o te rohi pū-hāmani. I te ha’amatara’a o te tahua-’ohipa, ua tītauhia te mau mātini ha’ama’aro miti nō tē ha’amau i te mau vaira’a nā te mau motu, i muri a’e, ua tu’uhia te mau mauha’a nō te orara’a maita’i, mātini ha’amahanahana pape e te mau vāhi tapi vai e haumiti :
Page 12
| 1963 | 1964 | 1965 | ’Āmui |
’Ohipa rarahi |
|
|
|
|
Fa’atahera’a pape (tuiō, rōpīnē, tāmaura’a…) | 15 | 1 083 | 161 | 1 259 |
Tauiha’a uira (niuniu, mātini…) | 41 | 162 | 363 | 566 |
Pū ha’ama’arora’a | 55 | 9 | 2 | 66 |
Ha’amahanahana pape | – | 4 | 7 | 11 |
Tapi vai e haumiti | – | 25 | 65 | 90 |
Mau tauha’a hāponohia mai nā te haumetua mai i te CEP mā te rahira’a tane [57]
Ua ine te hi’ora’a a te mau fa’ehau i te fāri’ira’a te mau Porinetia i teie fa’atau’āpīra’a māteria. E ’ohie maita’i a’e te Porinetia ia ’apo, hau atu a’e i te taure’a Farāni, i roto i te mau ’ihiha’a tau’āpī nō te patura’a fare e te mātini. E mea au nā na te ’ahopa i te pae nō te ra’atira pupu ». Ua mana’o o Thiry ’e’ita te mau rave-’ohipa Porinetia e hina’aro e fa’a’ō i roto i te ’ōpura’a nō te fa’ahotura’a fa’anahohia nō Porinetia « papa-ana’e-hia i ni’a i te fāri’ira’a rātere e te mau rohi tāpiri », mai te peu ē ’e’ita te mau huimana e fa’aitoito ia mara’a mai te mau ti’a fa’atere ta’ata fenua : « Tē ’itehia nei i te tahi ’ōti’ati’a o te mau tāne e vahine Porinetia nō tē fāri’i i te mau ’ohipa ha’iha’i a’e, mai te ’ohipa hōtera ’ei hi’ora’a. ’E’ita teie ’ōti’ati’ara’a e ’ore mai te peu ē e hōro’ahia ia rātou ra te mau ’ahopa, i muri a’e i tō ratou fa’aineinera’a tōro’a e au i te reira » [58]. I te pae hope’a, ua tae o Thiry i te fāri’i ē « ’aore e ira fa’aha’iha’i tō te Porinetia ia fa’aauhia i te “popa” [papa’ā], e « e fāri’i ’ino roa atu ’oia ia « tā-’āua-fa’ehau-hia » ’oia i roto i te parau nō te hi’ora’a o te ’oire-’āua-fa’ehau, ’inaha e riro i te noa’a atu te mau ’ohipa i roto i te tātā’ī pahī, te mau ’ohipa huira’atira. [59]
I muri a’e i te CEP : fa’aineinera’a rave-’ohipa tāmoni nō te fa’anahora’a pū-’ohipa
Mā tē tītaura’a i tē tihepu i te ta’ata fenua, i fa’ariro na o Messmer i te CEP ’ei mauha’a nō te fa’ahotura’a ia Porinetia. E rave rahi taime tōna fa’a’itera’a i tōna hina’aro e fa’arahi i te rahira’a ta’ata porinetia [60]. Tāna fa’aotira’a matamua nō te reira, i te 14 nō te ’āva’e ’atopa matahiti 1965 ra, e ferurira’a ïa nō te ho’ē muriatau hina’arohia nō te ho’ē Porinetia fa’atau’āpīhia nā roto i te vai-maoro-ra’a mai te CEP, o tei ’ore i tupu hānoa na i te ’ōmuara’a o te ’ōpuara’a, e te ho’ē ha’amaura’a i te mau mana-ha’a (compétence) ’āpī i Tahiti :
Tē vai-ha’amaoro-raahia mai o te mau rahira’a ta’ata haumetua i Porinetia nei […] tē faatupu nei te reira nā te Fenua nei i te ho’ē ’ōrura’a hāmanihia o te mau punavai o tei […] riro i tē ha’afānau mai i te ha’apararīra’a o te CEP, e tahi ïa fifi
Page 13
rahi. Mā te hiro’aro’a i teie fifi, ua fa’aue te haufenua […] i te fa’anahonahora’a i muri nei :
- a) I Tahiti, te mau rāve’a pū-hāmani e pa’epa’e-’ohipa mā tē rave i te rave-’ohipa nō te fenua nei, aratai’hia e te ho’ē rahira’a iti māmā nō te mau haumetua ;
- b) Nā te mau motu, ’ei mau fa’aineinera’a fa’ehau ta’a’ē o tei tītau auta’a i te rave-’ohipa nō te fenua nei.
Ua nāmua te tenerara Crépin i te vaitāmaura’a o te ’ohipa-tāmoni i roto i te ho’ē tōtaiete mātau i te ’aimamau : « ua fa’atupu te monira’ahia i te mau hina’aro (vespa, pere’o’o, fa’ato’eto’era’a, ’āfata teāta, etv…), e nō te hina’aro ha’amāha i te mau hia’ai, e riro atu i tē fa’aiti mai i te mau-pāpū-’ore-ra’a i roto i te ’ohipa » [61]. I te ’āva’e tetepa matahiti 1966 ra, ua tītau ’oia i te « ho’ē tuatāpapra’a ia ti’a i te rave-’ohipa porinetia i muri a’e i te tahi fa’aineinera’a o tei riro i te maoro roa atu nō te mea ua fa’anahohia te CEP e tae roa atu i te matahiti 1975 ra » [62]. Ia au i teie te huru hi’ora’a, tē fa’a’itehia ra te fare ha’api’ira’a ’ei ’e’a nō te « fa’atau’āpīra’a ». I te matahiti 1965 ra’a ra, ua fa’aau o Thiry i te fa’aineinera’a nō te « mau ’aravihi-ta’a-maita’i e nō te mau fa’atere porinetia » ’ei « mea faufa’a nō te muiriatau o Porinetia e nō te tāpe’ara’a i teie Fenua i roto ia Farāni ». Nō teie « “fa’atau’āpīra’a” ia Porinetia i roto i te mau tuha’a ato’a, tauirara’a, mau ha’apūrorora’a, rātio, te ’āfata teāta, mau pere’o’o, mau manureva, mau manuā, etv… », ua tītau ’oia i te ho’ē i te IG ra o Brunet nō te Ha’api’ira’a a te Hau i haere mai ia au i te anira’a a te CEA i te CEP « nō tē tuatāpapa i te arata’ira’a ha’api’ira’a e te tauturu e tano ia ha’apa’ohia e te CEP nō te ha’api’ira’a ». ’A’ita o Thiry e mana’o i te mau pū-’ohipa ana’e ra, tē fa’aō-ato’a-ra’a mai nei rā i roto i te fa’arava’ira’a faufa’a pū-hāmanira’a : « E ti’a ia arata’ihia te fa’aineinera’a i te mau taure’a e pōti’i Porinetia nā te ’e’a i hina’arohia na. E mea pāpū maita’i ē [e fa’aineinera’a] ’ihiha’a mauā te reira. I te mau matarara’a o te Ha’api’ira’a a te Hau, e ti’a ia ’āmuihia atu te mau ’ohipa fa’ehau e hōro’ahia mai e te Nu’u, te Pāito, te ho’ē BIMAT fa’atauihia, etv. » Tē nāmua nei ’oia i te parau « ia au i te hoho’a nō tei ravehia na i Antilles, [nō te] ’ohipa fa’ehau fa’atanohia » [63].
I te pae hope’a, ua tu’u te mau punavai ta’ata i te mau uiuira’a nō te pa’epa’e-’ohipa e nō te fāito-hōpoi’a, e ’oia ato’a rā nō te poritita, nā te pū’oira’a i rotopū i te mau fa’ehau e te haufenua. Te perera’a, faufa’a nō te patura’a i te CEP e tōna fa’a’ohipara’a matamua, tē fa’ahoho’a mai ra i te ti’amāra’a e fāna’ohia ra e te tenerara Thiry, i roto i te fa’atupura’a i te tāpura o te mau tārena nō te mau tāmatamatara’a, ’ei tātā’ī i te hape ha’amāramarama’a e tāfifihia ra e ana nō te reira tuha’a. Ia au i te putuputura’a matamua a te Tomite a te CEP, o te tītau ia fa’anaho i te mau rave’a o tāna e fāna’o atu nō te mau tārena e fā mai ra, tē ’ite ra te reira ia Bernard Tricot, fa’aa’o nō te Élysée, i te pū’oira’a i te hina’aro o te feiā poritita « ia tuatāpapahia te ho’ē fa’ahaerera’a i Hao » mai te ho’ē « tuha’a faufa’a nō te fa’arava’ira’a faufa’a ». Ua pāto’i Thiry i te fa’auera’a nei : « Te fifi, o te hi’ora’a ’ihimana’o ïa ia fa’aauhia i te hiro’aro’a. Ua ’ī o Hao mai te ho’ē huero moa, e ’e’ita te mana’o e fē’a’a, e ’ī atu ā ’ona i te mau taime ato’a e ravehia ai te mau tūpitara’a. E au ’ona i te tahi huru roro-pua’a (cevelas) i fa’autahia i ni’a i te ’iriatai o te pape » [64]. I roto rā i teie iho nei putuputura’a nō te ’āva’e tiurai matahiti 1966 ra, ua fa’a’ite te mau ti’a teitei roa a’e o te mau Nu’u i tō rātou ta’a-’ore nō te vaira’a mai o te ho’ē tārena i te matahiti 1967 ra, ia au i te reira, e riro te parau fa’aau nō ’Āreteria i te te fa’aroahia atu ā e ’aore rā ’e’ita, tē vaivai pāpū-’ore ra te fa’auera’a poritita [65]. Ua arata’i te reira ia Thiry ia rūhānoa, i te matahiti 1967 ra, i te fa’anahora’a nō te 2ra’a o te tārena e ia fa’atae i te mau tupuarahi nā te ho’ē fāito teitei : « E aha ïa rahira’a tane fifi ! E riro atu te reira ’ei temeio mai te peu noa atu e manuia tātou ! » [66].

![Effectifs globaux constatés et prévus en octobre 1965 Effectifs globaux constatés et prévus en octobre 1965 [footnote]SHD, GR 9 R 89, rapport des contrôleurs Emery et Bidon, octobre 1965 (en jaune données incertaines, reconstituées).[/footnote]](https://dictionnaire-cep.upf.pf/wp-content/uploads/2025/02/Effectifs-globaux-constatés-et-prévus-en-octobre-1965.jpg)
![Évolution des effectifs militaires CEP de juin 1964 à juin 1966 Évolution des effectifs militaires CEP de juin 1964 à juin 1966 [footnote]Ibid.[/footnote]](https://dictionnaire-cep.upf.pf/wp-content/uploads/2025/02/Évolution-des-effectifs-militaires-CEP-de-juin-1964-à-juin-1966.jpg)