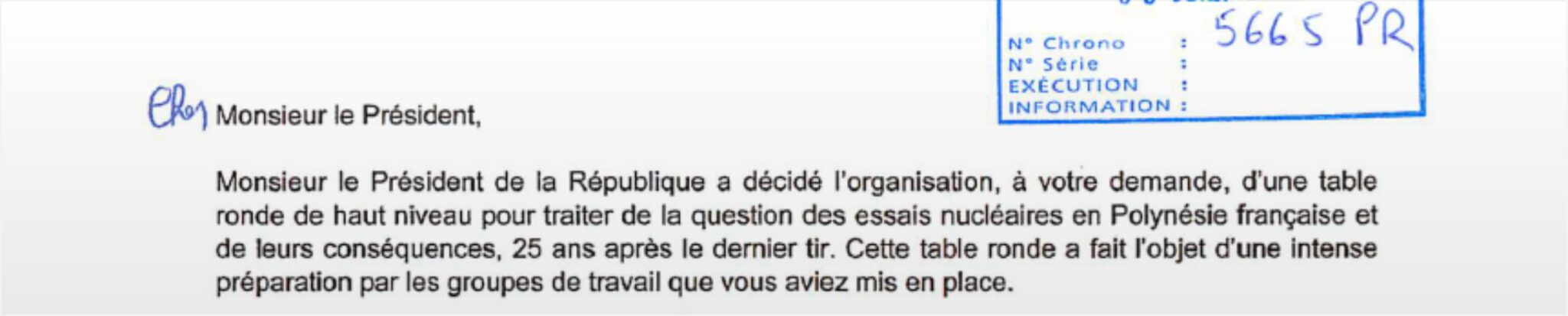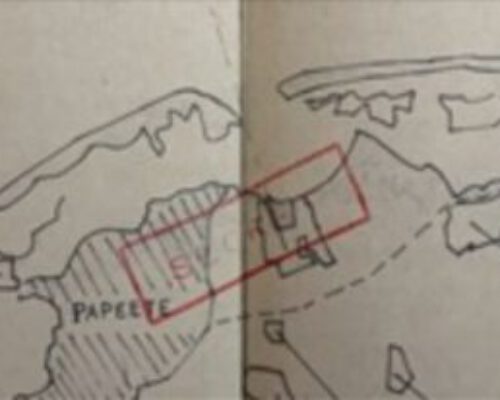Page 1
Te fa’aterera’a hau o te Ara Moana, mai tōna pūra’a mai ’e tae atu i te mau tāmatamatara’a ’ātōmī Farāni hope’a i Patitifa ’apato’a (1959-1996).
’Ia au i tōna huru i teie mahana, ’ua ti’a mai te fa’aterera’a hau o te Ara Moana – tōna i’oa mai te matahiti 2012- i te ’āva’e tenuare nō te matahiti 1959,i muri a’e i te tau o te uiuira’a mana’o mana nō te ’āva’e nō tetepa nō te matahiti 1958.’Ua fa’ata’a ’ē ’oia te huru o te mau fenua mero nō te ivinūna’a Farāni e vai ra i te fenua ’Afirita ’e te fenua Madagascar, i te mau fenua o te Ara Moana (DOM-TOM) [1], ’e ’ua ha’amanahia te fa’a’orera’a i te fa’aterera’a hau ’o te hau Farāni ’o te mau fenua nō te Ara Moana i ha’amauhia i te matahiti 1946 nō te monora’a i te fa’aterera’a hau o te mau fenua ’aihu’arā’au. ’Ua horo’ahia te ti’a’aura’a o te mau fenua nō te Ara Moana i te fa’aterera’a hau ’āpī tei pi’ihia nō te Sahara, te mau fenua nō te Ara Moana[2]. ’Ua horo’ahia te fa’aterera’a ia Jacques a Soustelle tāne, e ti’a pāpū nō te pupu poritita « gauliste », tei mātarohia nō tōna pāto’i-’ū’ana-ra’a i te fa’ati’amāra’a fenua, i te aroā Oudinot ’oia, i roto i te mau fare i noho.hia na e te fa’aterera’a hau o te mau fenua ’aihu’arā’au mai te matahiti 1910 ’e tae atu i te matahiti 1946, ’e tei pārahihia e te fa’aterera’a hau o te hau Farāni ’o te mau fenua nō te Ara Moana (hoho’a 1)
Figure 1
 Hoho’a ti’ara’a mana ’ore a Wikipedia. “Te tomora’a o te fa’aterera’a hau o te Ara Moana, 27 aroā Oudinot, Pari (’āva’e nō mē, i te matahiti 2012)”.
Hoho’a ti’ara’a mana ’ore a Wikipedia. “Te tomora’a o te fa’aterera’a hau o te Ara Moana, 27 aroā Oudinot, Pari (’āva’e nō mē, i te matahiti 2012)”.
Page 2
I te ha’amaura’ahia, i te ’āva’e nō tenuare nō te matahiti 1959, e riro tāna fa’aterera’a a te hau ’ei ha’aputuputura’a i te mau piha tōro’a i vai na, i tu’uhia na i raro a’e i te pārurura’a a te mau fenua o te fa’aterera’a hau ta’a’ē mau[3]. Nā te pāpa’ira’a parau nui o te mau fenua “DOM” e ti’a’au i te mau fenua nō Antilles-Guyane ’e Réunion, o tē tae roa i te fa’aterera’a hau o te mau ’ohipa roto o te fenua, tē pūai fa’ahou atu nā roto i te fāna’ora’a i te tahi piha ’ohipa mai roto mai i te fa’aterera’a hau o te faufa’a; nā te fa’aterera’a o te mau fenua “TOM”, nō roto mai i te fa’aterera’a hau ’o te hau Farāni ’o te mau fenua nō te Ara Moana, e ti’a’au i te mau fenua « TOM ». I roto i teie nā fa’anahora’a e piti, e ’itehia te tahi fāito-’ore-ra’a, te fāna’o ra te mau fenua « DOM ». I te pū o te fa’aterera’a hau, te piha fa’atere i te pāpa’ira’a parau nui, tei fāna’o i te papa ture « fa’aterera’a tonoha’a a te hau[4]», tei ruru i te mau rāve’a faufa’a ato’a a te fa’aterera’a hau, tē ha’apāpū ra i te tahi hia’ai nō terā mau fenua « DOM », ’aore roa te mau fenua « TOM » e fāna’o. Tē fa’a’ite ra te ture tāpura nō te mau fenua DOM nō te 30 nō tiurai nō te matahiti 1960, i te tahi nu’ura’a rahi nō te fāito moni a te hau e rurihia i te hō’ē piha ’ohipa ‘ai’āpu’u, ’āre’a te ti’a’aura’a o te mau fenua « TOM », e hi’ora’a ’e e ferurira’a nui, i te mea ē e fenua tei riro ’ei fenua ti’ara’a fāna’o nō te pārurura’a, mai tōna mau nūna’a ato’a, i te ferurira’a Farāni ta’a’ē ’ia fa’aauhia i tō te mau nūna’a o te mau fenua « DOM », ta’ata ’āi’a Farāni mai te matahiti 1848[5] mai.
Nā teie huru hi’ora’a ta’a’ē mau e fa’ata’a maita’i i te huru o te mau pirita’ara’a e vai ra i roto pū i te aroā Oudin ’e te tahi atu mau pū fa’atere a te hau, e DOM ānei, e TOM ānei. I raro a’e i te fa’aterera’a a Charles de Gaule tāne, ’e ’o Georges a Pompidou tāne, te ti’a’aura’a o te mau TOM, ’o Pōrīnētia ho’i te pito pitopito nō te parau o te ’ātōmī, e au ra ē e tomo roa atu i roto i te « tuha’a pūtohe » a te peretiteni, nō te parau o te pārurura’a i te fenua, e tū’ati ato’a i te fa’aterera’a hau a te nu’u e te ’Āua mūto’i o te Ito ’Ātōmī (AIA) nō te parau o te Pū tāmatamatara’a ’Ātōmī nō Patifita. ’Ei ha’apāpūra’a, tē tītau-tāmau-ra’a nā roto i te hō’ē ravera’a pūai, tāpa’o nō te « tuha’a pūtohe » a te fa’atere o te Hau mai te ta’ata raupe’a o te ti’amāra’a o te fenua Farāni : te tītaura’a i te mau ’apo’ora’a iti o te mau ta’at i raro a’e i tāna fa’aterera’a[6]. ’Aita tō te aroā Oudinot e fa’aō roa mai i Pōrīnētia Farāni nei nō te mau ’ohipa o te ’ātōmī, e fa’atura rā i te mau a te Hau Farāni nō te vai-hau-noa-ra’a i te pae o te poritita o te fenua ’e te pārurura’a i te mau maita’i ’e te pūai o te Hau Farāni ; te tumu ïa i ’ū’ana ai te mau hi’opo’ara’a a te Pū tuatāpapara’a ’e mā’imira’a (Ser) ’e tāna mau piha tuatāpapara’a (BE), tei vai i raro a’e i te fa’aterera’a a te mau tāvana hau[7]. E fa’atupu teie mau fa’auera’a i te tahi ti’ara’a o te fa’aterera’a hia’aihia, inaha ’ua tae roa i te ti’ara’a o te fa’aterera’a hau, i fāna’o i te ti’ara’a teitei fa’ahiahia, e rave rahi taime, o te fa’aterera’a hau o te Hau Nui, tū’ati roa i te aora’i o te “Elysée” nā roto i te tonoha’a faufa’a roa a te peretetini o te Hau repupirita Farāni nō te mau fenua o te Ara Moana, ’o Jacques a Foccart tāne[8].
Page 3
En 1981, l’alternance socialiste semble amorcer une nouvelle ère, laissant planer la possibilité d’une remise en cause des institutions de la Ve République, susceptible de se répercuter sur l’action de l’État Outre-mer. Depuis le début des années 1970, les socialistes métropolitains perçoivent en effet les DOM-TOM, et singulièrement les territoires du Pacifique sud, comme des territoires néocoloniaux, appréhendant l’action de l’État à travers une grille de lecture tiers-mondiste[9]. Le Programme commun de la gauche de 1972 classe d’ailleurs symboliquement les DOM-TOM dans la partie consacrée à la politique extérieure. Dans ces conditions, le maintien d’un département ministériel à part entière ne paraît pas assuré en cas d’alternance politique. Durant la campagne présidentielle de 1981, le candidat Mitterrand n’a eu de cesse de clamer le droit à l’autodétermination des peuples d’Outre-mer, ouvrant potentiellement la voie aux indépendances et à une intégration des services de la rue Oudinot au ministère de la Coopération[10]. Ces perspectives sont cependant vite écartées au moment de l’accession au pouvoir de François Mitterrand. La débâcle socialiste dans les DOM-TOM lors de l’élection présidentielle de 1981 pousse Henri Emmanuelli, secrétaire d’État aux DOM-TOM auprès du ministre de l’Intérieur de 1981 à 1983, à la plus grande prudence. Tout projet de suppression de la rue Oudinot est ajourné, tandis que sont maintenus à leur poste ses principaux cadres, sans volonté de substituer à la haute fonction publique traditionnelle un personnel venu du militantisme, dans une optique de spoil system à la française. Le maintien à ses fonctions du directeur des affaires politiques, administratives et financières, Jean Montpezat, entré rue Oudinot en 1967, et ayant servi Foccart pendant cinq ans à l’Élysée de 1969 à 1974, illustre cette continuité administrative. Tout au plus, au plan institutionnel, le pouvoir socialiste met en œuvre, en 1984, des réformes de nature autonomiste en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, provoquant notamment dans ce dernier territoire la déception du camp indépendantiste. Le pic de violence politique qui en résulte pousse le gouvernement à créer en mai 1985 un poste de ministre de plein exercice, spécifiquement chargé de la Nouvelle-Calédonie. La démission de son titulaire, Edgard Pisani, met fin dès novembre 1985 à cette éphémère expérience ministérielle qui avait amputé la rue Oudinot de la gestion d’un territoire dont elle avait la charge depuis l’origine. De mars 1986 à mai 1988, la cohabitation avec la droite voit la rue Oudinot retrouver son statut de ministère de plein exercice avec la nomination du gaulliste Bernard Pons au sein du gouvernement de Jacques Chirac. Pendant cette période, l’organisation du ministère évolue avec la nomination, sous la
Page 4
tutelle du ministre, du Polynésien Gaston Flosse au poste de secrétaire d’État chargé des problèmes du Pacifique sud, qui conduit son action depuis Papeete[11]. Dans une optique typiquement gaulliste, envisageant les DOM-TOM comme des vecteurs de puissance et d’influence, le secrétariat d’État de Gaston Flosse a pour tâche de faire rayonner l’action de la France à l’échelle régionale, dans un contexte de contestation croissante lié aux essais nucléaires français en Polynésie et aux événements en cours en Nouvelle-Calédonie depuis 1984. L’existence de ce secrétariat d’État, liée à la relation d’amitié qui unit Jacques Chirac à Gaston Flosse, ainsi qu’à la volonté du premier de récompenser le second pour sa proximité avec le RPR, ne survit cependant pas à cette première période d’alternance.
Lors de l’élection présidentielle de 1988, les larges succès remportés par François Mitterrand dans la plupart des DOM-TOM (54,5% en Polynésie française au second tour) valident le bien-fondé d’une approche politique de l’Outre-mer plus pragmatique, loin des conceptions idéologiques empreintes de tiers-mondisme des années 1970. En 1988, les socialistes font le choix de maintenir la « formule gaulliste » d’un ministère de plein exercice, mieux en phase avec les attentes des grands élus ultramarins, dont le rôle d’instance de médiation politique entre le centre et ses périphéries d’Outre-mer a eu nettement tendance à se renforcer depuis le début des années 1980, sous le double effet de la décentralisation dans les DOM et des statuts d’autonomie dans les TOM (cf. poids d’Aimé Césaire et de Paul Vergès sous les gouvernements de gauche, puis de Gaston Flosse pour la droite). En 1988, la fonction de ministre des DOM-TOM est confiée à Louis Le Pensec, un proche de Michel Rocard, qui se maintient en fonction jusqu’en 1993 – égalant le record de longévité du gaulliste Louis Jacquinot en poste de 1961 à 1966 – avec pour feuille de route, s’agissant de la Polynésie française, la gestion des conséquences financières du moratoire sur les essais nucléaires De 1993 à 1995, durant la seconde cohabitation, son successeur Dominique Perben poursuit ces différents chantiers, notamment celui concernant la Polynésie française, qui aboutit à la loi du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel du territoire[12]. S’installe ainsi véritablement, au cours du second mandat de François Mitterrand, l’idée d’une continuité de l’action de la rue Oudinot tendant à atténuer l’acuité du clivage gauche-droite – loin des oppositions tranchées d’avant 1981 – et l’effet des alternances politiques. La politisation de la reprise des essais nucléaires en 1995, exacerbée par la récente situation de cohabitation, apparaît comme l’une des dernières grandes mises en scène de profonde divergence entre la droite et la gauche de gouvernement au sujet de l’Outre-mer.
Progressivement, depuis 1959, le ministère des Outre-mer s’est ainsi imposé comme un acquis institutionnel que nul ne songe désormais, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’État, à remettre en cause. À l’origine, sa pérennité était pourtant loin d’être acquise, tant ses premières années se sont déroulées dans un contexte mouvant, à la fois marqué par l’accession à la souveraineté des États d’Afrique subsaharienne, que les architectes gaullistes de la Communauté française n’avaient pas imaginé dans des délais si courts, et l’indépendance de l’Algérie. Néanmoins, l’éloignement progressif du spectre de la décolonisation de ces territoires après 1962, en dépit de violents épisodes de contestation comme à Djibouti ou en Guadeloupe en 1967, finit par l’installer dans le paysage institutionnel de la Ve République comme un instrument légitime de gestion de territoires périphériques, perçus comme nécessitant un traitement « spécifique ». Cette installation progressive n’a pourtant pas réussi à mettre un terme à ses changements récurrents d’échelon – ministère ou secrétariat d’État, de plein exercice ou délégué auprès du Premier ministre ou du ministre de l’Intérieur –, attestant d’une incapacité à définir une formule stable de gouvernement central des Outre-mer.