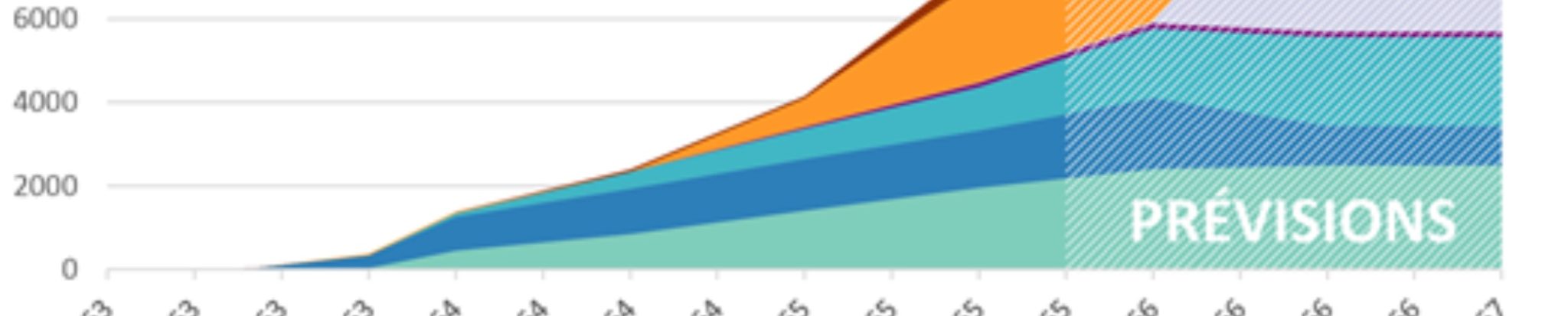Page 1
Le ministère des Outre-mer, de sa création aux derniers essais nucléaires français dans le Pacifique Sud (1959-1996).
Sous sa forme actuelle, le ministère des Outre-mer – tel est son nom depuis 2012 – apparaît en janvier 1959, dans le prolongement du référendum constitutionnel de septembre 1958. Ce dernier vient de dissocier le sort des États membres de la Communauté française, situés en Afrique et à Madagascar, de celui des départements et territoires d’Outre-mer (DOM-TOM)[1], et d’acter, ainsi, la disparition du ministère de la France d’Outre-mer, créé en 1946 en remplacement du ministère des Colonies. La gestion des DOM-TOM se voit alors confiée à un nouveau ministère dit du Sahara, des départements et territoires d’Outre-mer[2]. Attribué à Jacques Soustelle, un fidèle gaulliste connu pour son opposition à toute idée de décolonisation, celui-ci se maintient rue Oudinot, dans les bâtiments occupés par le ministère des Colonies de 1910 à 1946 et réinvestis ensuite par celui de la France d’Outre-mer.
Figure 1
 Image libre de droits Wikipedia. « L’entrée du ministère des outre-mer, 27 rue Oudinot, Paris (mai 2012) ».
Image libre de droits Wikipedia. « L’entrée du ministère des outre-mer, 27 rue Oudinot, Paris (mai 2012) ».
Page 2
Lors de sa création, en janvier 1959, son administration centrale prend la forme d’un regroupement de services existants, placés auparavant sous la tutelle de départements ministériels distincts[3]. La gestion des départements des Antilles-Guyane et de la Réunion échoit ainsi à un secrétariat général des DOM, directement transféré du ministère de l’Intérieur, qui se renforce à l’occasion par l’absorption d’un service issu du ministère des Finances ; celle des territoires d’Outre-mer (TOM) revient, quant à elle, à une direction des TOM, héritière du ministère de la France d’Outre-mer. Cette structure duale se caractérise d’emblée par un déséquilibre au profit des DOM. Au sein du ministère, l’ascendant du secrétariat général des DOM, doté du statut d’« administration de mission »[4], concentrant l’essentiel des moyens ministériels, atteste d’une ambition pour ces départements, sans équivalent pour les TOM. La loi de programme pour les DOM du 30 juillet 1960 induit une nette croissance du montant des transferts publics au service d’un objectif de « rattrapage », tandis que la gestion des TOM reste marquée par une conception plus impériale de ces territoires, considérés avant tout comme des opportunités stratégiques, comme de leurs habitants, dont le caractère français paraît moins évident que celui des « domiens », citoyens depuis 1848[5].
Cette perception différenciée détermine la nature des relations qu’entretient la rue Oudinot avec d’autres administrations, selon qu’il s’agisse des DOM ou des TOM. Sous Charles de Gaulle et Georges Pompidou, la gestion des TOM, dont la Polynésie constitue le cœur névralgique du fait de son « statut nucléaire », tend en effet à s’intégrer au « domaine réservé » présidentiel en matière de défense nationale, en liaison avec le ministère des Armées et le commissariat à l’énergie atomique (CEA) pour ce qui concerne le Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP). En atteste le recours fréquent à une pratique de pouvoir, caractéristique du « domaine réservé » du chef de l’État en tant que garant de l’indépendance nationale : la convocation de conseils restreints, directement placés sous son autorité[6]. À l’endroit de la Polynésie française, la rue Oudinot n’intervient donc pas directement dans les affaires nucléaires mais assure néanmoins des missions régaliennes essentielles, destinées à garantir la stabilité politique du territoire et à préserver les intérêts de la puissance française ; d’où l’ampleur des activités de surveillance déployées par l’entremise de sa Section d’études et de recherche (SER) et de ses Bureaux d’études (BE), placés sous l’autorité des gouverneurs[7]. Ces missions lui confèrent malgré tout une position gouvernementale enviable, qui se traduit par son accession au rang de ministère de plein exercice, doté à plusieurs reprises du statut honorifique de ministère d’État, directement connecté à l’Élysée par l’entremise du puissant conseiller présidentiel pour les DOM-TOM, Jacques Foccart[8].
Ce schéma institutionnel perdure jusqu’en 1974, même si celui-ci connaît son âge d’or avant 1969, sous les présidences gaulliennes. Il répond alors à un dessein bien précis, découlant de la vision hautement stratégique que les gaullistes se font de la Polynésie française. Il permet aussi de combler les attentes de la frange la plus « loyaliste » de la classe politique polynésienne : l’existence d’un ministère de plein exercice, en relation directe avec l’Élysée, apparaît en effet comme une preuve de considération, en même temps qu’un moyen de conjurer le spectre d’un abandon par la métropole. En 1974, l’élection du président Giscard d’Estaing vient bousculer ce schéma, avec notamment la mise à l’écart de son principal architecte, Jacques Foccart. Jusqu’en 1986 et le retour aux affaires de la droite gaulliste, le statut de ministère est ainsi dénié à la rue Oudinot, au profit de celui de secrétariat d’État, avec en sus un rattachement au ministère de l’Intérieur à partir de 1976 : un tel changement est vécu par certains hauts fonctionnaires proches des réseaux gaullistes, tel l’ancien secrétaire général des DOM (1972-1977), le préfet Jean-Émile Vié, comme un déclassement de l’Outre-mer au sein de l’agenda gouvernemental[9].
L’organisation interne des services ministériels est également affectée par la volonté réformatrice du nouveau président, convaincu de la nécessité de faire évoluer une structure administrative qui a été pensée par les gaullistes au nom d’une certaine idée de l’Outre-mer. Deux grandes directions thématiques, aux compétences transverses, conçues pour surmonter l’opposition entre les DOM et les TOM, voient ainsi le jour en 1979 : l’une en charge des affaires politiques, administratives et financières, l’autre des affaires économiques, sociales et culturelles[10]. La réforme répond à un souci de rationalité interne au ministère visant à atténuer, entre les deux services, les différences de culture professionnelle et les esprits de corps dans un contexte de départs en retraite croissants d’agents issus des corps de l’ancienne administration coloniale qui contrôlaient la direction des TOM depuis 1959. Il s’agit aussi d’imposer l’Outre-mer comme une catégorie d’action publique, étendue aux questions économiques et sociales, au-delà de ses composantes régaliennes. Enfin, les changements mis en œuvre par les deux secrétaires d’État aux DOM-TOM qui se succèdent au cours de mandat de Giscard, Olivier Stirn (1974-1978) et Paul Dijoud (1978-1981), conduisent à une redéfinition des leviers d’action de l’État dans certains TOM mais surtout du périmètre géographique de la compétence ministérielle. Au nom d’une approche politique qui se veut plus libérale, un premier statut dit d’autonomie de gestion administrative et financière est accordé en 1977 à la Polynésie française, où les contestations du CEP n’ont cessé de s’intensifier, tandis que s’engagent, dans d’autres territoires, des négociations débouchant sur les indépendances des Comores (1975), de Djibouti (1977) et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides (1980).
Page 3
En 1981, l’alternance socialiste semble amorcer une nouvelle ère, laissant planer la possibilité d’une remise en cause des institutions de la Ve République, susceptible de se répercuter sur l’action de l’État Outre-mer. Depuis le début des années 1970, les socialistes métropolitains perçoivent en effet les DOM-TOM, et singulièrement les territoires du Pacifique sud, comme des territoires néocoloniaux, appréhendant l’action de l’État à travers une grille de lecture tiers-mondiste[11]. Le Programme commun de la gauche de 1972 classe d’ailleurs symboliquement les DOM-TOM dans la partie consacrée à la politique extérieure. Dans ces conditions, le maintien d’un département ministériel à part entière ne paraît pas assuré en cas d’alternance politique. Durant la campagne présidentielle de 1981, le candidat Mitterrand n’a eu de cesse de clamer le droit à l’autodétermination des peuples d’Outre-mer, ouvrant potentiellement la voie aux indépendances et à une intégration des services de la rue Oudinot au ministère de la Coopération[12]. Ces perspectives sont cependant vite écartées au moment de l’accession au pouvoir de François Mitterrand. La débâcle socialiste dans les DOM-TOM lors de l’élection présidentielle de 1981 pousse Henri Emmanuelli, secrétaire d’État aux DOM-TOM auprès du ministre de l’Intérieur de 1981 à 1983, à la plus grande prudence. Tout projet de suppression de la rue Oudinot est ajourné, tandis que sont maintenus à leur poste ses principaux cadres, sans volonté de substituer à la haute fonction publique traditionnelle un personnel venu du militantisme, dans une optique de spoil system à la française. Le maintien à ses fonctions du directeur des affaires politiques, administratives et financières, Jean Montpezat, entré rue Oudinot en 1967, et ayant servi Foccart pendant cinq ans à l’Élysée de 1969 à 1974, illustre cette continuité administrative. Tout au plus, au plan institutionnel, le pouvoir socialiste met en œuvre, en 1984, des réformes de nature autonomiste en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, provoquant notamment dans ce dernier territoire la déception du camp indépendantiste. Le pic de violence politique qui en résulte pousse le gouvernement à créer en mai 1985 un poste de ministre de plein exercice, spécifiquement chargé de la Nouvelle-Calédonie. La démission de son titulaire, Edgard Pisani, met fin dès novembre 1985 à cette éphémère expérience ministérielle qui avait amputé la rue Oudinot de la gestion d’un territoire dont elle avait la charge depuis l’origine. De mars 1986 à mai 1988, la cohabitation avec la droite voit la rue Oudinot retrouver son statut de ministère de plein exercice avec la nomination du gaulliste Bernard Pons au sein du gouvernement de Jacques Chirac.
Page 4
Pendant cette période, l’organisation du ministère évolue avec la nomination, sous la tutelle du ministre, du Polynésien Gaston Flosse au poste de secrétaire d’État chargé des problèmes du Pacifique sud, qui conduit son action depuis Papeete[13]. Dans une optique typiquement gaulliste, envisageant les DOM-TOM comme des vecteurs de puissance et d’influence, le secrétariat d’État de Gaston Flosse a pour tâche de faire rayonner l’action de la France à l’échelle régionale, dans un contexte de contestation croissante lié aux essais nucléaires français en Polynésie et aux événements en cours en Nouvelle-Calédonie depuis 1984. L’existence de ce secrétariat d’État, liée à la relation d’amitié qui unit Jacques Chirac à Gaston Flosse, ainsi qu’à la volonté du premier de récompenser le second pour sa proximité avec le RPR, ne survit cependant pas à cette première période d’alternance.
Lors de l’élection présidentielle de 1988, les larges succès remportés par François Mitterrand dans la plupart des DOM-TOM (54,5% en Polynésie française au second tour) valident le bien-fondé d’une approche politique de l’Outre-mer plus pragmatique, loin des conceptions idéologiques empreintes de tiers-mondisme des années 1970. En 1988, les socialistes font le choix de maintenir la « formule gaulliste » d’un ministère de plein exercice, mieux en phase avec les attentes des grands élus ultramarins, dont le rôle d’instance de médiation politique entre le centre et ses périphéries d’Outre-mer a eu nettement tendance à se renforcer depuis le début des années 1980, sous le double effet de la décentralisation dans les DOM et des statuts d’autonomie dans les TOM (cf. poids d’Aimé Césaire et de Paul Vergès sous les gouvernements de gauche, puis de Gaston Flosse pour la droite). En 1988, la fonction de ministre des DOM-TOM est confiée à Louis Le Pensec, un proche de Michel Rocard, qui se maintient en fonction jusqu’en 1993 – égalant le record de longévité du gaulliste Louis Jacquinot en poste de 1961 à 1966 – avec pour feuille de route, s’agissant de la Polynésie française, la gestion des conséquences financières du moratoire sur les essais nucléaires De 1993 à 1995, durant la seconde cohabitation, son successeur Dominique Perben poursuit ces différents chantiers, notamment celui concernant la Polynésie française, qui aboutit à la loi du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel du territoire[14]. S’installe ainsi véritablement, au cours du second mandat de François Mitterrand, l’idée d’une continuité de l’action de la rue Oudinot tendant à atténuer l’acuité du clivage gauche-droite – loin des oppositions tranchées d’avant 1981 – et l’effet des alternances politiques. La politisation de la reprise des essais nucléaires en 1995, exacerbée par la récente situation de cohabitation, apparaît comme l’une des dernières grandes mises en scène de profonde divergence entre la droite et la gauche de gouvernement au sujet de l’Outre-mer.
Progressivement, depuis 1959, le ministère des Outre-mer s’est ainsi imposé comme un acquis institutionnel que nul ne songe désormais, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’État, à remettre en cause. À l’origine, sa pérennité était pourtant loin d’être acquise, tant ses premières années se sont déroulées dans un contexte mouvant, à la fois marqué par l’accession à la souveraineté des États d’Afrique subsaharienne, que les architectes gaullistes de la Communauté française n’avaient pas imaginé dans des délais si courts, et l’indépendance de l’Algérie. Néanmoins, l’éloignement progressif du spectre de la décolonisation de ces territoires après 1962, en dépit de violents épisodes de contestation comme à Djibouti ou en Guadeloupe en 1967, finit par l’installer dans le paysage institutionnel de la Ve République comme un instrument légitime de gestion de territoires périphériques, perçus comme nécessitant un traitement « spécifique ». Cette installation progressive n’a pourtant pas réussi à mettre un terme à ses changements récurrents d’échelon – ministère ou secrétariat d’État, de plein exercice ou délégué auprès du Premier ministre ou du ministre de l’Intérieur –, attestant d’une incapacité à définir une formule stable de gouvernement central des Outre-mer.