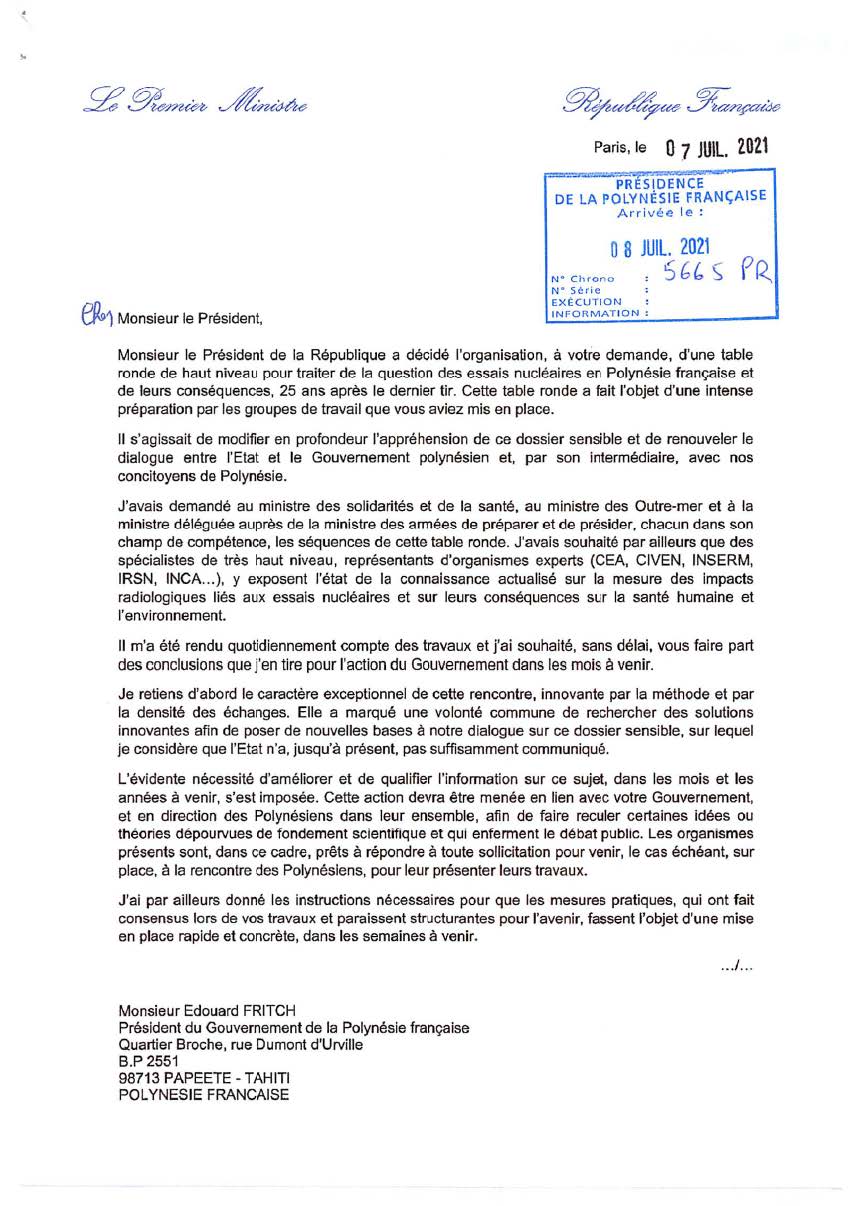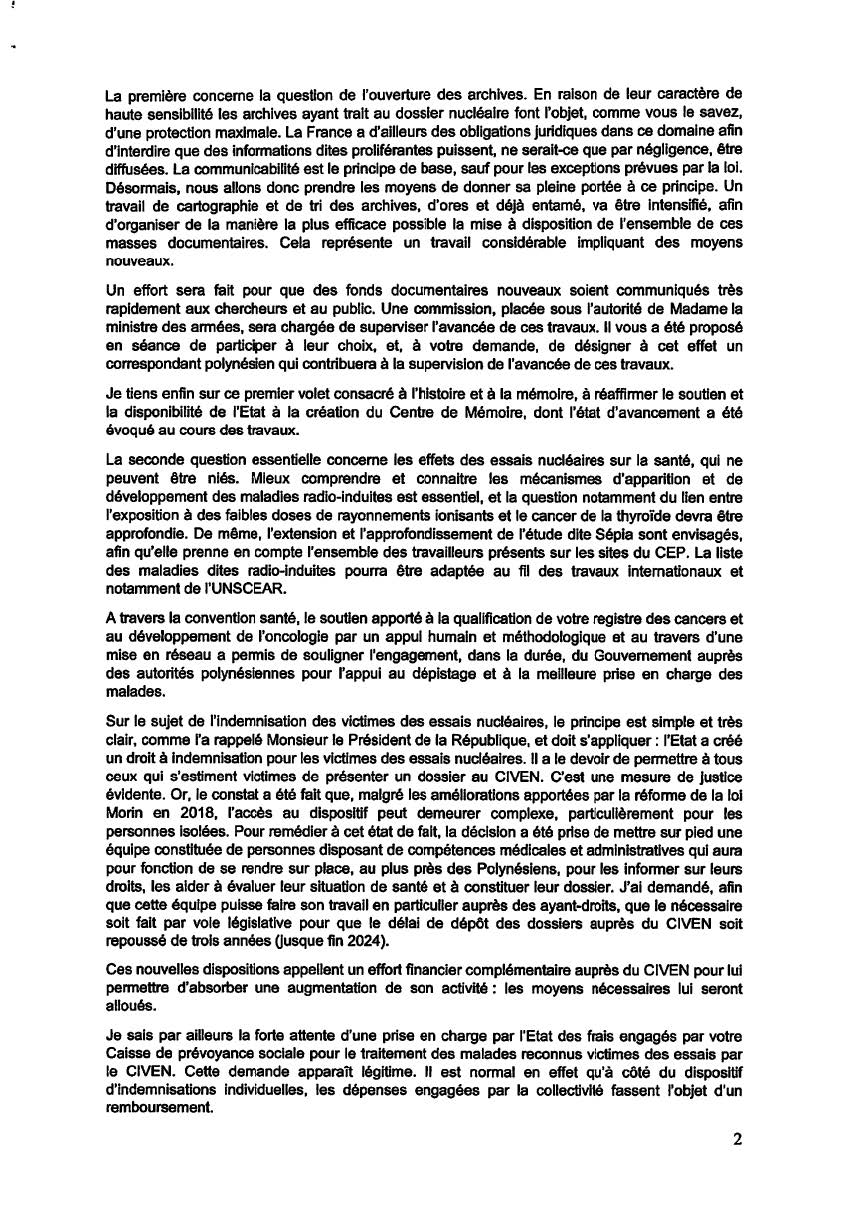Page 1
La décision prise par le gouvernement à l’été 2021 de déclassifier les archives relatives aux essais nucléaires en Polynésie française a créé une rupture. Sans minorer tout ce qui a pu s’accomplir auparavant, ni préjuger de l’avenir alors que les archives des essais sahariens restent inaccessibles, ce processus permet de jeter une lumière neuve sur bien des aspects du CEP : le choix du site, la politique de sûreté, les enjeux environnementaux et sanitaires des essais, la dimension transnationale de la mise au point de l’arme, les conséquences locales, régionales et internationales des trente années d’explosions nucléaires dans les Tuamotu…
Les restrictions qui empêchaient d’accéder aux archives régaliennes, sans lesquelles il n’est pas possible d’écrire une histoire complète du CEP, sont à ce jour largement levées du côté du Service Historique de la Défense, de l’ECPAD ou du ministre des Affaires étrangères. Mais l’inertie demeure du côté du CEA ou de la DGA, ce qui revient à maintenir le verrou antérieur à la décision de l’été 2021 pour certains enjeux du CEP, notamment dans le domaine sanitaire et environnemental.
L’ère de l’histoire orale : le CEP d’abord connu par les témoignages
L’histoire du nucléaire militaire a été intimement mêlée aux institutions productrices de l’arme, à savoir le CEA chargé de sa conception, et les Armées qui ont reçu la responsabilité d’organiser la mise au point de l’arme dans les différents sites d’essais choisis par les militaires en Algérie puis en Polynésie. Ce premier âge historiographique, ouvert dans les années 1980, était deux fois institutionnel : proposant une histoire par le haut, centrée sur les responsables officiels et rédigée en dépendance étroite avec eux, sans offrir pour autant d’accès libre à leurs archives. Le secret a couvert jusqu’à certains des organes producteurs des décisions, de sorte que le paysage institutionnel où chemine la décision politique en matière d’atome militaire demeure flou. Le Comité des Explosifs nucléaires, créé par un décret du 26 octobre 1954[1], puis le Comité des sites lointains, qui planifie le programme des tirs, demeurent largement méconnus de la communauté savante. C’est également vrai de la direction des relations internationales du CEA ou de l’analyse stratégique de la DAM, faute d’accès aux archives des atomistes. Ainsi, l’histoire politique de la bombe s’est écrite en décrivant d’autres niveaux de décision, négligeant paradoxalement des sources accessibles (les débats parlementaires, les archives des partis, récemment exploités par la thèse de Yannick Pincé[2]), ignorant jusqu’à l’échelon décisif du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, dont les archives ont pourtant commencé à s’ouvrir avant les déclassification de 2021[3].
Page 2
Ce que les universitaires ont pu produire dans ce contexte a suscité une sorte de contrepoint : une littérature militante qui s’est attachée à documenter les silences de l’historiographie et à déconstruire le discours officiel sur les enjeux sanitaires des essais nucléaires réalisés en Algérie puis en Polynésie française. Elle a mobilisé des témoins permettant d’écrire une histoire des pratiques ordinaires de la mise au point de la bombe sur les sites d’essais.
Ainsi, la première histoire du nucléaire militaire en France a été prise en charge par deux groupes qui partageaient le recours à l’histoire orale mais s’ignoraient largement, faute de dialoguer dans des arènes communes (colloques, revues) appartenant aux mêmes circuits de diffusion :
- des historiens, qui ont pu avoir accès aux acteurs institutionnels et à leurs témoignages dans le cadre d’une entreprise internationale et comparatiste : la branche française du Nuclear History Program voué à collecter de la documentation archivistique et orale et à susciter et financer des travaux puis à soutenir leur publication[4]. Le GREFHAN (Groupe d’études français sur l’histoire de l’armement nucléaire), était piloté par l’historien des relations internationales Jean-Baptiste Duroselle, l’un de ses élèves, Maurice Vaïsse en assurant la responsabilité opérationnelle[5]. Cette création a lieu en 1987, ce qui accentue l’effet de symétrie avec :
- le Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC), centre d’expertise non académique fondé à Lyon en 1984 par des militants antimilitaristes. Bruno Barrillot (1940-2017), appelé à jouer un rôle majeur dans la société polynésienne comme lanceur d’alerte sur les conséquences sanitaires des essais avec Patrice Bouveret s’est mobilisé dans le contexte militant de la crise des euromissiles. L’objectif était de montrer le coût de la dissuasion à travers une expertise que la sphère académique ne fournissait qu’imparfaitement. Dans ce cadre, le témoin recherché n’était pas le décideur mais la victime des essais, opérateur ou riverain des sites, susceptible d’apporter un contre-récit à la rhétorique de l’innocuité de la mise au point de l’arme atomique française[6].
L’histoire des essais nucléaires relève de l’histoire politique mais aussi de l’histoire de la science et des techniques, de l’environnement, du fait colonial et impérial. Les chercheurs de ces champs ont été largement dissuadés de travailler sur la base des sources régaliennes, qu’il s’agisse des Archives nationales, ou des administrations qui n’y versent pas leur archives et disposent de leurs propres centres : le Service Historique de la Défense en ses différents sites (Vincennes, Brest pour la marine, Châtellerault pour la fabrication de l’arme, Pau pour le personnel), mais aussi le CEA-DAM, cette institution n’assumant pas son obligation d’offrir au public une salle de consultation des archives avec mise à disposition d’inventaires.
En 1998, l’éphémère ouverture des archives de Vincennes sous le gouvernement Jospin a permis les révélations dans le Nouvel Observateur du journaliste Vincent Jauvert sur l’importance des retombées lors de la première campagne du CEP[7]. Le CDRPC prend la mesure de l’importance des archives régaliennes pour documenter la politique de sûreté et les enjeux sanitaires. Barrillot et Bouveret s’allient à différentes institutions pour revendiquer l’accès aux
Page 3
sources militaires, mais ignorent d’autres fonds qui s’avèreront féconds : le SGDSN, dépendant de Matignon ; les archives diplomatiques ; les Archives nationales. L’appel à l’ouverture des archives est co-signé en 1999 par le CDRPC, l’Église évangélique en Polynésie française et le Conseil Œcuménique des Églises (Suisse) qui fait le lien entre les militants Polynésiens et Européens contre le nucléaire. Il reste lettre morte[8].
Après le rapport de Barrillot paru en 2005, « Les Polynésiens et les essais nucléaires. Indépendance nationale et dépendance polynésienne », qui met en lumière le secret et les incohérences des données publiées par les autorités sur les retombées, le Ministère de la défense réplique en 2006 avec « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie. À l’épreuve des faits », qui prétend clore la question de l’accès aux sources sur les retombées radiologiques. Ce que le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense (DSND), Marcel Jurien de la Gravière, assume lors de sa venue à Tahiti en 2008 : « Je rappelle qu’il avait été confirmé qu’il n’y aura pas de déclassification de ces archives ».
Une histoire empêchée : le coût documentaire de la loi de 2008 et la voie du contentieux
Cette fermeture des archives sur le CEP a été scellée par la loi, à l’occasion de la réforme du Code du Patrimoine de 2008. Libérale dans son économie générale, elle est plus restrictive que jamais concernant le fait nucléaire pour lequel est forgé une notion inédite dans l’histoire française : la notion d’inaccessibilité perpétuelle. Justifié par les obligations de signataire du Traité sur la non-prolifération (TNP), l’article L213-2 interdit à titre perpétuel la communication d’une archive publique au caractère « proliférant », défini comme « susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques […] »[9]. L’application extensive de la loi, dans la pratique administrative de la communication des archives, s’est manifestée pour des articles aussi anodins et nullement « proliférants » que le chantier d’agrandissement du port de Papeete (demande au SHD, refusée par l’auteur en 2008) ou des impacts économiques du CEP (demande refusée en 2019). La loi a ainsi vitrifié la recherche sur les essais nucléaires pendant une douzaine d’années. L’incohérence de son application s’est maintes fois manifestée : l’historien Jean-Marc Regnault a publié des articles à propos du CEP à partir d’un article du SHD de la série GR R (Archives du Cabinet du ministre) devenu inconsultable à partir de 2008. Mais ses notes demeuraient accessibles à la bibliothèque de l’UPF, sans que les autres chercheurs puissent se faire une idée directe du volume et s’y confronter pour croiser leur analyse à la sienne. Malgré les déclassifications décidées en 2021, l’article L213-2 de la loi de 2008 n’a pas été abrogée et demeure une contrainte pour les historiens du nucléaire, en-dehors du périmètre de déclassification qui concerne le seul CEP, ce qui explique que des chercheurs insistent sur la continuité des politiques de secret entourant les essais nucléaires[10].
La pratique a montré que l’argument de la non-prolifération était un prétexte pour empêcher de documenter les aspects embarrassants de la mise au point de la bombe, qu’il s’agisse des relations avec les territoires ultra-marins et les anciennes colonies ou des enjeux sanitaires et
Page 4
environnementaux. Dès 2011, Maurice Vaïsse dressait ce constat désabusé : « ce bilan historiographique pourrait, si l’on n’y prend garde, prendre l’allure d’un avis de décès »[11]. S’ouvre ainsi une période pauvre pour l’historiographie, alors que le délai de 50 ans aurait dû permettre d’accéder aux archives des premiers essais réalisés en Algérie. En matière d’histoire de la santé, un arrêté pris la même année que la loi de 2008 (le 1er avril) établit que seuls « les organismes de recherche à caractère sanitaire et/ou épidémiologique » ont accès à la « Liste des travailleurs du centre d’expérimentation du Pacifique » établis par la DGA et à ses données à caractère personnel, dont la finalité est la gestion des dossiers médicaux des travailleurs du centre d’expérimentation du Pacifique, tandis que les Armées confient en 2009 à un groupe privé, Sepia Santé, la tâche d’exploiter une partie de ces fonds pour une enquête épidémiologique.
Ces fermetures à géométrie variables sont devenues encore plus difficiles à réguler lorsque la loi Morin a créé en 2010 un Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) dont les membres ont accès aux archives classifiées. La frustration engendrée par l’application de cette loi, et le besoin de justifier de sa présence sur les sites contaminés pour les anciens travailleurs, a conduit les associations de vétérans à faire le choix du contentieux pour obtenir la déclassification de sources permettant de documenter leur histoire personnelle, à commencer par les risques sanitaires auxquels ils ont été exposés. La procédure judiciaire, appuyée sur la loi du 10 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs, s’est avérée longue et complexe. Le Tribunal administratif de Paris (TA) a rendu un jugement favorable aux plaignants (l’AVEN et Moruroa e tatou) le 10 octobre 2010, ce que le Conseil d’État a validé en cassation le 20 février 2012[12], conduisant le ministre de la Défense à admettre, via la Commission du Secret de la Défense Nationale (CSDN), la nécessité de faire connaître au TA l’avis de la commission de déclassification[13]. Au final, ce sont 245 documents qui ont été déclassifiés et sont devenus accessibles aux chercheurs pour autant qu’ils avaient eu vent de la procédure par leur proximité avec l’une ou l’autre des associations de vétérans.
Le gouvernement décide de déclassifier (juillet 2021), ce qui permet de renouveler le questionnement historiographique
La mémoire empêchée ou du moins contrariée par l’impossibilité d’écrire une histoire documentée du CEP a fini par aboutir au déblocage d’une partie des archives du nucléaire militaire.
La tentative de liquider ce passé a d’abord pris un tour économique : ce fut le « pacte de progrès » défini en 1993 pour penser l’après CEP, dans la foulée du moratoire décidé par F. Mitterrand. En 2016, François Hollande a commencé à affronter les héritages des essais à l’occasion de sa venue à Papeete : son discours répond au vœu formulé par le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée de Polynésie en 2005 en reprenant la notion d’un Institut à vocation mémorielle « afin que la jeunesse polynésienne n’oublie pas cette période de notre Histoire commune », tout en souhaitant, en une formule presque contradictoire, « tourner la page du nucléaire »[14]. Un an plus tard, le 17 mars 2017, la signature des accords de l’Élysée sur la
Page 5
reconnaissance du fait nucléaire[15] confirme en son article 1.1.2 la mise en place d’un « Institut d’archives, d’informations et de documentation destiné à faire connaître l’histoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française ». Le processus qui prévoit une action conjointe de l’État et du Pays, permet la cession par l’État d’un bâtiment (hôtel de la Marine) et engendre un groupe scientifique chargé de penser son contenu. Ce groupe chargé de penser le centre de mémoire sous l’égide de la Délégation au Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires (DSCEN), administration du Territoire, a été relayé par un Conseil scientifique en août 2024[16].
La tâche s’avère ardue du fait des déficits historiographiques évoqués plus haut. Bernard Dumortier avait certes produit une première synthèse utile de l’histoire des sites polynésiens, en suivant une approche technique – l’auteur a une formation en sciences de la nature. Elle laisse toutefois peu de place à l’agentivité des Polynésiens et néglige la question des effets sur le territoire en dehors des polygones de tirs, qu’il s’agisse de l’environnement ou de la société[17].
Entretemps, sous les mandats de François Hollande puis d’Emmanuel Macron différentes initiatives politiques ont favorisé la connaissance historique des questions sensibles liées au passé colonial du pays, qu’il s’agisse de l’affaire Audin, de la commission Rwanda ou du rapport Stora, et a pu prendre la forme d’ouverture de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles[18]. Dans cet esprit, la Polynésie française (DSCEN, service dirigé par Yolande Vernaudon) a financé le programme de recherche « Histoire et mémoires du CEP » visant à améliorer la connaissance de l’histoire des essais. Piloté par la MSH du Pacifique, ce programme a permis de lancer une nouvelle campagne d’entretiens avec des vétérans et plus largement les populations polynésiennes. Mais la déclassification des archives étaient également visées. L’article 3 de la convention entre le territoire et la MSHP signée à la fin de l’année 2018, prévoit : « La Polynésie française s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’ouverture d’archives nouvelles et à leur accès par les chercheurs du présent projet afin de permettre sa réalisation effective ». Ces démarches politiques ont trouvé leur efficace après la sortie de Toxique, ouvrage accompagné d’une modélisation des retombées et de leurs conséquences qui contestaient les affirmations invérifiables des armées et du CEA[19]. L’écho médiatique (reprises des conclusions par des journaux français et européens) a contribué à relancer la controverse sur les enjeux sanitaires du CEP et conduit le CEA à répondre à travers un ouvrage qui maintient ses positions sur les retombées[20].
La réponse de l’État aux accusations de dissimulations sur l’ampleur et les conséquences des retombées a pris la forme d’une table-ronde dite de très-haut niveau, en juillet 2021, ce qui a permis d’affronter les aspects sanitaires et financiers de la dette nucléaire. Sur le front des archives, la table-ronde a été la scène d’une décision mûrie avant le voyage du président Marcon en Polynésie : un processus de déclassifications opérées dans le cadre d’une commission. Le gouvernement avait prévu de restreindre l’appartenance à cette commission de déclassification des archives du CEP à des membres qualifiés des services producteurs (CEA et Armées). Les discussions animées de la table-ronde ont permis d’y compter des représentants de la Polynésie et non pas les seuls services producteurs, ce qui a été confirmé par la lettre du Premier ministre au président Édouard Fritch dans la foulée :
Page 6
Page 7
Lettre du premier ministre Jean Castex au président Edouard Fritch le 7 juillet 2021 confirmant l’engagement d’ouvrir les archives du CEP pris pendant la table ronde des 1er et 2 juillet 2021.
Le site mémoire des hommes tient à jour l’ouverture des archives de cinq institutions : les Archives nationales, le SHD, l’ECPAD, la DAM, la DGA pour le Département de Suivi des centres
Page 8
d’expérimentations du nucléaire[21]. Le processus de déclassification est à ce jour très inégalement appliqué par les administrations concernées : avec loyauté par le SHD et la Courneuve (MAEE) ou l’ECPAD, avec parcimonie pour la DGA et son Département du Suivi des Centres d’expérimentations nucléaires, avec dédain de la part du CEA-DAM, qui se dérobe à ses devoirs. La création au printemps 2024 d’une Commission d’enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires, présidée par Didier Le Gac, dont la rapporteur Mereana Reid Arbelot, députée polynésienne, est à l’initiative, a créé une nouvelle dynamique jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale décidée le 9 juin 2024. En octobre 2024 (date la rédaction de cette notice), la commission est à nouveau à l’ordre du jour de la nouvelle législature.
D’un point de vue historiographique, il est trop tôt pour juger de l’effet des déclassifications décidées en 2021. Ces déclassifications, mais aussi les archives territoriales (SPAA), devraient permettre de renouveler les questionnements liés à l’histoire des essais, en synergie avec les évolutions historiographiques plus générales. La question du genre se pose, comme celle de l’environnement, en des termes renouvelés par l’histoire des pollutions et des controverses scientifiques sur les enjeux sanitaires. Il s’agit d’associer les historiens de la santé, de l’économie, de la société, et bien d’autres disciplines (géographie, anthropologie, sociologie) pour penser tout l’empan chronologique de l’histoire du CEP, qui ne s’arrête pas avec le démantèlement officiel.